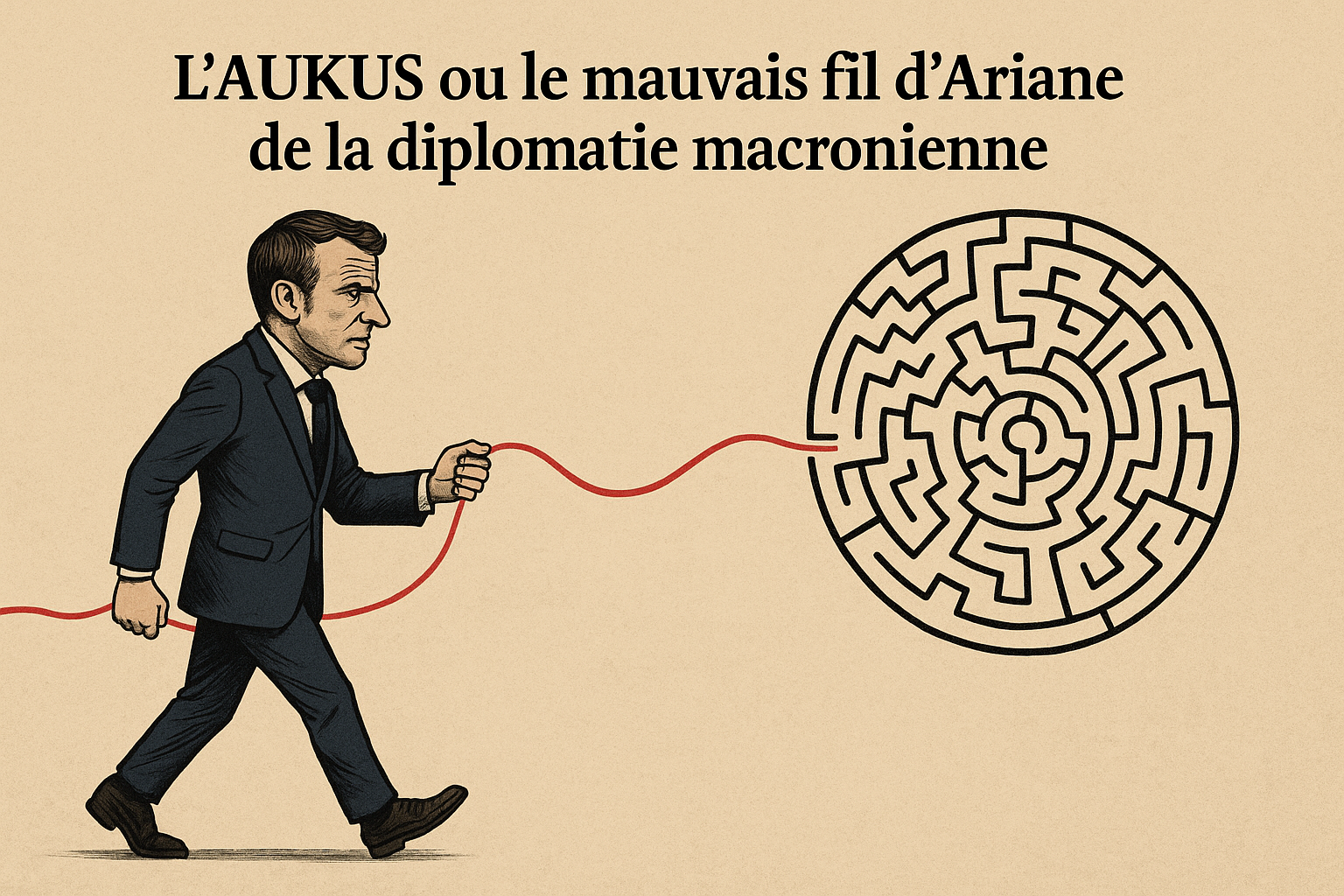Le junk food : l’autre poison des Antilles françaises
...et des outre-mer
Didier Levreau - directeur de la revue guadeloupéenne PerspekTives
Quand sur un territoire donné la quantité de produits frais consommés diminue ; quand les boissons et aliments industriels représentent l’essentiel de ce que consomme la population; quand au lieu de presser un fruit local pour en extraire le jus on achète des boissons industrielles chargées en additifs et en sucre présentées dans des emballages au marketing « attractifs » les effets prennent quelques années pour devenir visibles, mais ils le deviennent.
Et quand ces territoires sont des îles dépendantes d’importations massives ces effets peuvent prendre des dimensions alarmantes. Parler de santé publique, de surpoids et d’importations fort discutables en pleine période de carnaval – en Guadeloupe, en Martinique et dans la Caraïbe – n’est pas opportun, jugeront certains lecteurs. » C’est la fête ici, dans ce beau pays de Guadeloupe – peyi a nou – ne gâchez pas nos plaisirs et ceux des touristes qui remplissent les avions et les hôtels pour chercher plages, soleil et bonne humeur… »
Ok, ok, la face cachée des paradis tropicaux risque en effet de décourager les « Travel experts » payés pour vendre des « séjours de rêve au coeur de décors exotiques, face à la mer… » Alors oui, le soleil, la plage, la mer des Caraïbes, c’est beau et c’est bon, mais il est tout aussi important d’aimer les gens qui y vivent, leur culture, leur langue, leur musique, leur relation au monde… et leur bonne santé. C’est pour cela qu’il est impossible de ne pas revenir sur les effets toxiques et mesurés de la dégradation des modes de vie et des habitudes alimentaires dans les départements dits d’outre-mer sous la pression d’un modèle économique inadapté à ces pays.
Le constat est alarmant : « L’hypertension artérielle concerne de 39 % à 45 % des habitants de Guadeloupe, Martinique, Mayotte et La Réunion, quand elle affecte 31 % de l’ensemble de la population française. La prévalence du diabète atteint 10 % en Martinique, 11 % en Guadeloupe et 14 % à La Réunion, contre une moyenne nationale de 5 % (…) Les recherches montrent que les femmes, surreprésentées dans les catégories sociales les plus défavorisées, sont davantage concernées par les pathologies associées à l’obésité. A Mayotte, 79 % des femmes entre 30 ans et 69 ans sont en surcharge pondérale et, parmi celles-ci, 47 % sont obèses. »
Une société fragmentée se dessine : mélange de déni et de schizophrénie qui génère en même temps la promotion marketing de produits d’une industrie agroalimentaire aux effets néfastes sur l’organisme ; un idéal « bio » aux contours incertains ; et un système de santé qui a du mal à financer les conséquences de ces effets néfastes. Tout cela sur fond de paradis tropical pour tour operator.
Un modèle de développement mortifère qui produit de l’injustice sociale et alimentaire
Les chiffres cités plus haut ne sont pas tirés d’un panel établi par des rêveurs. Ils sont le résultat d’un travail confié à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), qui a réuni des experts de différentes institutions et acteurs locaux, dans le but de dresser un état des lieux de l’alimentation en outre-mer et de formuler des recommandations. Pourquoi, comment en arrive-t-on là ? L’expertise a été présentée au mois de novembre 2019 au ministère de la santé, qui devrait proposer, courant 2020, une traduction politique. À suivre donc.
À lire le rapport, les propositions politico-économiques proposées par le ministère devraient être en priorité la réduction des écarts sociaux entre les différentes couches de la population et la réduction des importations de produits alimentaires pour favoriser un « manger local ». Mais un ministre de la santé seul peut-il réduire les écarts sociaux, relancer les agricultures locales, créer des emplois, etc ?
Les chiffres sur l’état de « mauvaise santé » d’une large partie de la population des départements d’outre-mer sont la conséquence d’un long processus de développement ou plutôt de non-développement de ces territoires sur lesquels depuis plus de 30 ans un modèle économique artificiel a été plaqué. Ce modèle repose sur un mélange de monopoles, de rentes de situation, d’assistanat et de transferts sociaux, qui nuit à toutes formes de développement endogène. D’où dépendance exacerbée, d’où importations massives, d’où chômage, d’où fuite des jeunes les mieux formés.
Le constat établi par Caroline Méjean épidémiologiste à l’Institut national de la recherche agronomique ( INRA) est net : « J’ai été frappée, dit-elle, par les écarts sociaux de prévalence (1) sur ces territoires où les inégalités sont très fortes. » Une double peine en somme, voire triple peine est constituée : la prévalence des maladies chroniques provoquées par l’alimentation est plus forte parmi les populations défavorisées et parmi ces populations, les femmes sont les plus touchées. On le voyait, on le savait de manière intuitive en vivant dans ces pays, mais désormais une enquête sérieuse le documente. Pour la chercheuse cela soulève la question de la justice sociale.
Les causes de cette situation ?
Les deux premières sont la perte des habitudes alimentaires traditionnelles et la disparition progressive de l’agriculture locale. En Guadeloupe deux cultures d’exportation – la canne et la banane – captent l’essentiel des subventions publiques , occupent les terres et parfois les polluent pour des décennies – voir le cas de la banane et du chlordécone. Personne n'a osé au cours de ces trente dernières années remettre en cause ce modèle agricole rentable pour quelques uns mais destructeur pour le pays. Le lobby des gros planteurs qui ont longtemps vécu grâce aux subventions a imposé sa règle du jeu.
Le rapport de l’IRP montre que les jeunes en particulier se sont complètement détournés de la consommation de produits frais locaux, majoritairement, ils ne mangent ni légumes, ni fruits, ni produits laitiers, beaucoup moins que les mêmes tranches d’âges dans l’hexagone. Dans les DOM, les jeunes se nourrissent hors heures des repas, dans les commerces de rues et vont peu à la cantine scolaire.
Un troisième élément est le coût des produits de meilleure qualité ou frais. La faiblesse de la production locale fait que 80 à 90% des produits alimentaires sont importés dans ces territoires. Ils viennent essentiellement de l’hexagone et coûtent selon le rapport entre 20 et 30% plus cher qu’à Paris ou Marseille. Cela aussi on le savait, mais une fois de plus c’est écrit noir sur blanc.
Le rapport estime que le surcoût n’est pas seulement lié au transport : « l’étroitesse des marchés, les monopoles et la faible concurrence dans la grande distribution, la fiscalité locale, etc … ont leur part ». Faire baisser les prix pour que les plus modestes puissent aussi acheter des produits de qualité serait utile, mais un ministre de la Santé a-t-il ce pouvoir ?
Et puis il y a la teneur en sucre des produits de l’industrie alimentaire, bien trop importante. Il a fallu une loi en 2013 pour réduire la quantité de sucre contenue dans les produits vendues dans les départements d’outre mer, celle-ci pouvait aller jusqu’à 30 à 40% de plus dans certains yaourts. La loi existe, on ne peut plus vendre en Guadeloupe par exemple des produits plus sucrés que les produits les plus sucrés de l’hexagone, mais on reste ainsi dans une fourchette haute et la moyenne des produits vendus dans les DOM reste plus sucrée. Par ailleurs six ans après, cette loi n’a pas fait l’objet d’un suivi ni d’un contrôle de son application.
L’une des clés pour répondre au constat alarmant fait par l’IRD est à la fois simple et difficile à mettre en oeuvre, mais il n’y en a pas d’autres: lancer ou relancer la production locale de légumes, de fruits, de poissons dans ces territoires et réduire l’importation de produits alimentaires industriels.
Le meilleur outil de pression pour fixer de tels objectifs serait la prise de conscience par la population et la société civile de l’impasse dans laquelle les preneurs de décisions l’ont mise depuis des années ainsi que l’arme absolue du boycott. Si seulement 10 ou 20% de la population des DOM décidaient de ne plus consommer tel ou tel produit trop sucré ou nocif pour la santé, les résultats seraient rapides. Des mouvements, des associations s’inscrivent dans cette démarche – en Guadeloupe notamment – mais il reste du chemin à faire pour ralentir le rouleau compresseur de la grande distribution et de ses intérêts financiers.
Capri-sun, les méfaits du marketing
En 2018, l’ONG Foodwatch s’est attaquée à l’image du Capri-sun, cette boisson prisée par les jeunes, vendue avec une paille en plastique dans des pochettes en aluminium que par ailleurs on retrouve en quantité dans la nature et sur les plages. 213 millions de ces poches ont été vendues en France en 2016, un énorme business ni biodégradable, ni bon pour la santé. Ce produit n’a pas de grande qualité mais il est porté par des campagnes publicitaires coûteuses qui lui donne une image « jeune et sympathique ». Le piège ! Foodwatch dénonçait la publicité mensongère en direction des enfants, une boisson riche en fruits et en vitamines annonçait la pub, mais surtout bourrée de sucre. A l’époque, l’ONG évaluait quatre morceaux de sucre par pochette plus que dans un Fanta.

fast food pop art style vector illustration design | Designed by gstudioimagen / Freepik
La campagne « name and shame » ( nommé et faire honte) de l’ONG a en partie fonctionné, l’emballage a été modifié et la teneur en sucre a baissé. Ce n’est pas suffisant, le pas décisif serait que les parents n’achètent plus ce type de boissons de qualité médiocre, aux emballages polluants et dans la durée nocifs pour la santé.
Presser un fruit frais, réduire le sucre c’est simple et c’est possible sans les frais de marketing ni de pub démagogique que le consommateur paie en achetant ces produits industriels sous emballages.
(1) Prévalence : nombre de cas d’une maladie dans une population donnée
form-idea.com Antilles, le 24 janvier 2020. Avec nos remerciements à la revue PerspekTives.
Autres articles du même auteur:
Retour des statues béninoises : une question de dignité et d'identité
Autonomie territoriale : les questions sensibles à aborder
À Cuba, l'art plus fort que la Révolution
Derek Walcott : Beauté, Colonialisme & Mosaïque
Ano à Montréal : de la plantation à la consommation
Guadeloupe & EDF : désintérêt français envers les énergies renouvelables
"Batouala", histoire de la Centrafrique
L'Algérie coloniale vécue par un Antillais - Frantz Fanon, un psychiatre révolutionnaire