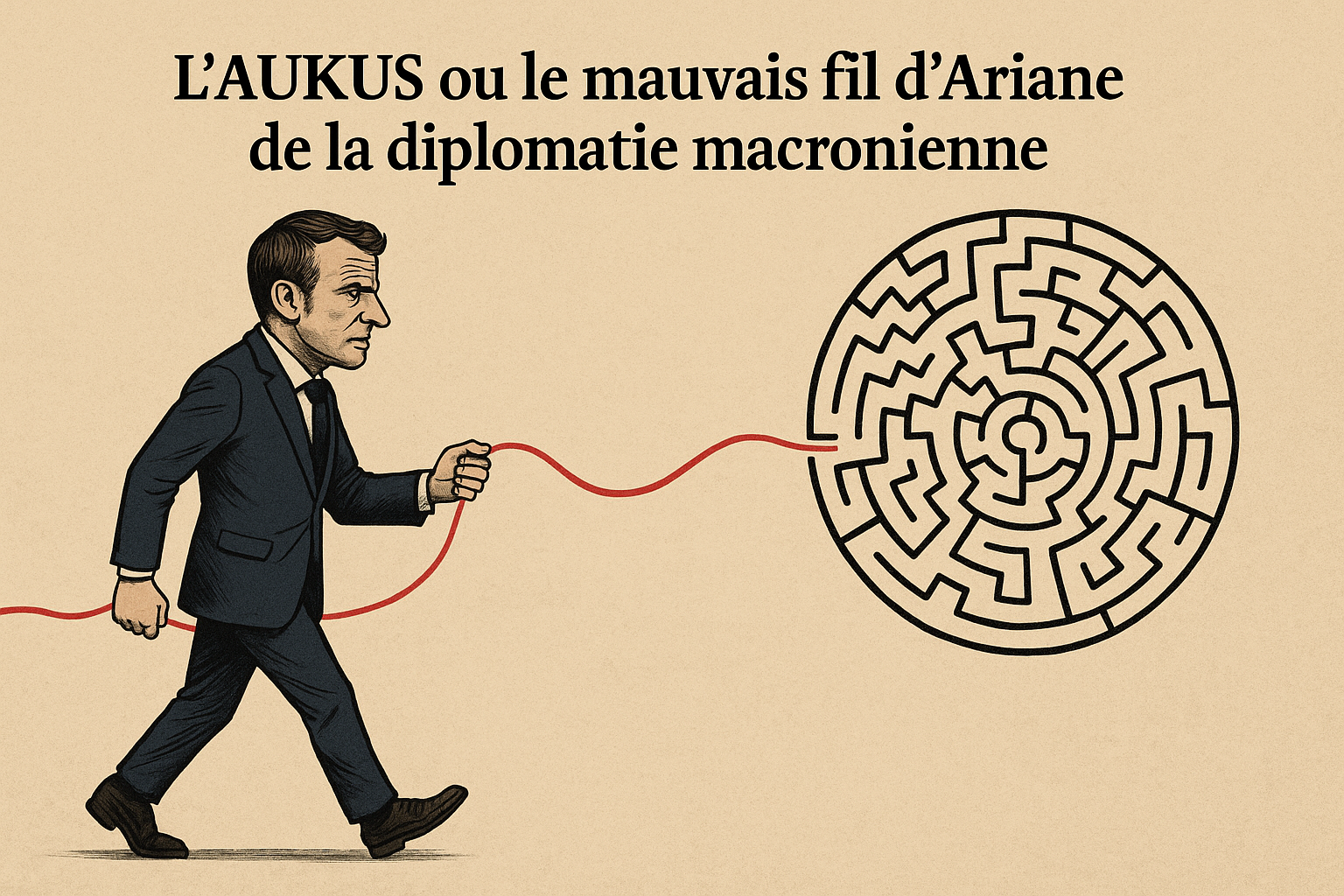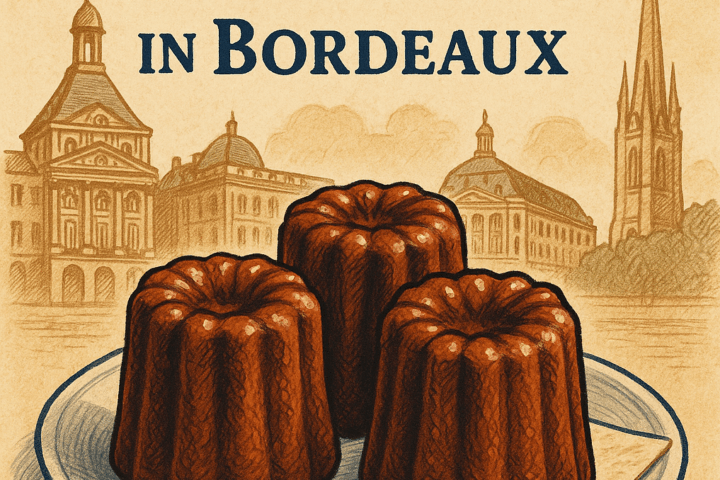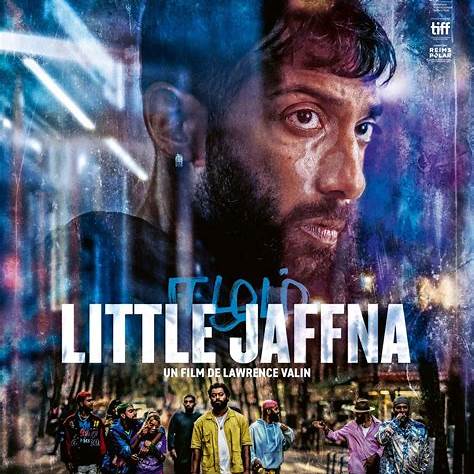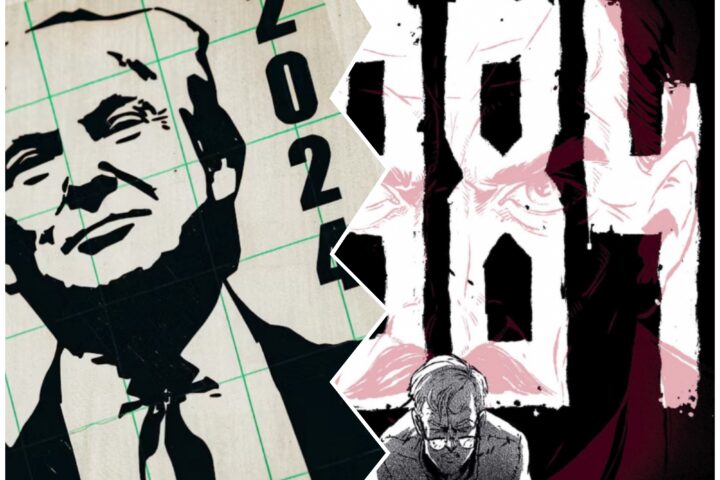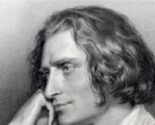L’AUKUS ou le mauvais fil d’Ariane de la diplomatie macronienne
La formation de l’alliance AUKUS, conclue sans la moindre consultation de la France, a marqué un tournant brutal dans les relations transatlantiques et révélé la fragilité de l’influence française sur la scène indo-pacifique. À travers une analyse du positionnement d’Emmanuel Macron — entre ambition européenne, humiliation diplomatique et réalignement stratégique — cet article explore les ressorts profonds d’une politique étrangère mise à l’épreuve par les rapports de force anglo-saxons, les tensions en mer de Chine, et la guerre en Ukraine. Faut-il y voir un échec personnel ou les limites structurelles de la puissance française dans un monde en recomposition ?
Versailles, Boutcha et les leçons de l’histoire
Lorsque le président Macron déclara devant le Parlement européen qu’il ne fallait pas humilier la Russie, alors même que le monde découvrait avec effroi les massacres perpétrés à Boutcha, nombre d’observateurs y virent une allusion au traité de Versailles de 1919. Ce texte fondateur, en attribuant à l’Allemagne la responsabilité exclusive de la Première Guerre mondiale, imposa à celle-ci des réparations financières écrasantes, d’importantes amputations territoriales, une stricte démilitarisation, ainsi que la confiscation de ses colonies. Perçu outre-Rhin comme un véritable diktat, il constitua une profonde humiliation nationale et alimenta un ressentiment durable, nourrissant chez les milieux nationalistes un esprit de revanche. L’on sait tragiquement à quelles extrémités cette dynamique mena l’Europe, vingt ans plus tard.
Le coup d’AUKUS : exclusion, mépris et rupture de confiance
Le président français gardait également en mémoire une expérience d’une tout autre nature, mais tout aussi marquante : l’humiliation provoquée par la mise en place de l’alliance AUKUS, partenariat militaire anglo-saxon réunissant l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, conclu en excluant délibérément la France. Cet accord stratégique, conçu pour contenir l’influence croissante de la Chine, avait été discrètement négocié dès le sommet du G7 en Cornouailles, sous l’égide du Premier ministre britannique Boris Johnson. Il marqua une rupture nette dans la relation jusqu’alors cordiale entre Emmanuel Macron et Joe Biden. L’on se souvient encore des images du chef de l’État français, affichant ostensiblement sa proximité avec son homologue américain, allant jusqu’à multiplier les gestes de connivence en public. Fort de son parcours dans la haute finance chez Rothschild & Co et de sa maîtrise de l’anglais, Emmanuel Macron aspirait à s’imposer comme une figure centrale du monde occidental libéral, un partenaire fiable et privilégié des États-Unis. L’affaire AUKUS sonna comme un désaveu cinglant de cette ambition.
À l’issue du sommet du G7 – au cours duquel Boris Johnson prit soin d’inviter le très impopulaire Premier Ministre australien, Scott Morrison – ce dernier se rendit à Paris pour y rencontrer les autorités françaises. Il affecta alors une cordialité de circonstance, donnant l’illusion d’une relation bilatérale apaisée, comme si rien ne venait troubler la coopération franco-australienne, dont l’un des fondements majeurs résidait dans le partenariat militaire, incarné par ce que l’on appelait déjà « le contrat du siècle » : la vente de douze sous-marins à propulsion diesel-électrique conçus par la France.
Le 15 septembre 2021, les trois pays annoncèrent au monde la formation de leur alliance stratégique – l’AUKUS – et la livraison à l’Australie de sous-marins à propulsion nucléaire anglo-américains, entraînant de facto l’annulation du « contrat du siècle » franco-australien signé en 2016, dont le montant s’élevait à quelque 90 milliards de dollars australiens. Cette décision constitua, aux yeux de Paris, une gifle diplomatique, voire une véritable trahison de la part d’alliés que la France considérait comme proches et fiables.
Emmanuel Macron, jusque-là fervent défenseur d’un dialogue transatlantique renforcé et réputé pour son américanophilie, fut profondément choqué. En réaction, il rappela ses ambassadeurs en poste à Canberra et à Washington — un geste sans précédent dans l’histoire des relations franco-américaines. Quant à Boris Johnson, perçu à Paris comme l’architecte cynique de cette manœuvre, il fut traité avec un silence méprisant, aucune mesure formelle n’étant prise à l’égard du Royaume-Uni, dont les rapports avec la France étaient déjà dégradés depuis le Brexit.
La légèreté avec laquelle Londres accueillit la crise n’eut d’autre effet que d’aggraver les tensions. La plaisanterie lancée par Johnson devant la presse – « donnez-moi un break » – en réaction à la colère française, fut interprétée comme une marque de dérision déplacée. À Paris, la suffisance et l’autosatisfaction britanniques face à ce coup diplomatique furent jugées proprement insupportables.
Le pragmatisme blessé d’Emmanuel Macron
Les autorités françaises auraient sans doute espéré être informées en amont par ceux qu’elles considéraient comme leurs plus proches alliés. Un compromis aurait pu être envisagé — par exemple, la livraison de quatre sous-marins français au lieu des douze initialement prévus — ce qui aurait permis à l’Australie de disposer de bâtiments modernes bien avant l’horizon 2040. L’attitude cavalière des partenaires anglo-saxons révéla, au grand jour, le peu de considération stratégique qu’ils accordent à la France, reléguée au rang de puissance secondaire dans une reconfiguration géopolitique à laquelle elle fut exclue sans ménagement.
Dès lors, il ne saurait y avoir lieu de s’étonner lorsque le président Macron affirme que les Européens ne doivent pas faire preuve de suivisme à l’égard de la politique étrangère de Washington. Lorsqu’il rappelle que la France n’est pas un État vassal, qu’elle adoptera une approche autonome vis-à-vis de la Chine, et qu’elle se refuse à toute forme de surenchère stratégique dictée par les États-Unis — dont l’AUKUS constitue désormais la pierre angulaire dans la région indo-pacifique —, il exprime moins une posture de défi qu’une volonté de préserver les intérêts fondamentaux de la France. En effet, il ne saurait être question, pour Paris, de cautionner un accord anglo-saxon perçu comme profondément préjudiciable à ses ambitions économiques et stratégiques dans cette zone cruciale.
La Chine : adversaire systémique ou acteur incontournable ?
Les critiques ont abondamment fusé sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias américains et européens. Si cette indignation peut se comprendre, elle n’en demeure pas moins fondée sur une lecture partielle, voire erronée, des enjeux. Il est indéniable que la montée en puissance de la Chine représente une menace sérieuse pour les démocraties libérales et nuit aux intérêts stratégiques des puissances occidentales. Pékin soutient sans ambages certains des régimes les plus autoritaires de la planète, tels que ceux de la Corée du Nord et de la Birmanie. Il refuse de condamner l’agression de la Russie contre l’Ukraine et, plus encore, lui apporte un soutien économique crucial en absorbant à prix cassés ses ressources énergétiques.
À l’intérieur de ses frontières, l’Empire du Milieu continue de réprimer les droits fondamentaux, sans tolérance pour la dissidence. À l’extérieur, il affiche une posture de plus en plus offensive, notamment en mer de Chine méridionale, où son expansionnisme maritime l’a conduit jusqu’à l’annexion de l’atoll de Scarborough, situé à proximité immédiate des côtes philippines. Pékin ne recule pas devant la diplomatie de l’intimidation : il exerce des pressions notables sur les États qui osent critiquer sa politique, comme l’Australie ou la Lituanie, tout en se posant en médiateur entre puissances rivales, à l’image de la récente normalisation des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite — initiative que la Chine a sciemment orchestrée à son avantage.
Taïwan, mémoire historique et ambiguïtés européennes
Comment la France pourrait-elle se désolidariser de Taïwan, démocratie vibrante dont le fonctionnement institutionnel suscite parfois même l’admiration au regard des propres lacunes françaises ? Il convient de rappeler que l’agresseur n’est ni Taipei ni Washington, mais bel et bien Pékin, dont les postures belliqueuses menacent l’équilibre régional.
Dans le subconscient collectif chinois persiste par ailleurs un puissant ressentiment envers l’Occident, nourri par les humiliations infligées au XIXe siècle. Les Britanniques, notamment, imposèrent à la Chine l’ouverture de son marché à la vente de l’opium, en violation manifeste de sa souveraineté. Ceux qui s’interrogent sur la profondeur de cette blessure historique n’ont qu’à se replonger dans La Vallée des Roses de Lucien Bodard, qui décrit avec une acuité poignante l’expédition punitive franco-britannique. Le pillage, le saccage puis l’incendie du somptueux Palais d’Été restent gravés comme un acte de barbarie impérialiste dans la mémoire nationale chinoise.
Dans ce contexte, la visite du président Macron à Pékin, censée ouvrir une voie diplomatique vers une résolution du conflit en Ukraine, n’a guère semblé produire d’effet tangible. Certains analystes estiment même que la venue, quelques jours plus tard, du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a eu un impact diplomatique plus marquant. Bien que Xi Jinping ait finalement accepté de s’entretenir par téléphone avec Volodymyr Zelensky le 26 mai, la Chine continue d’afficher une bienveillance stratégique à l’égard de la Russie, dont elle reste l’un des rares soutiens puissants sur la scène internationale.
Macron, l’Europe et les limites d’une autonomie stratégique
Cela étant dit, les Anglo-Saxons et leurs alliés auraient tort de s’acharner dans leurs critiques à l’encontre du président français. Certes, Emmanuel Macron peut agacer par une certaine forme d’arrogance ou de narcissisme, mais il n’en demeure pas moins un dirigeant résolument pragmatique, sur lequel l’Europe peut encore s’appuyer. Il a, il est vrai, tardé à armer les forces ukrainiennes, mais il fut néanmoins le premier à livrer des chars de combat à Kyiv — contribution essentielle dans les opérations de reconquête des territoires occupés.
Il convient par ailleurs de rappeler que la scène politique intérieure française est loin d’être uniformément favorable à l’aide militaire ou aux sanctions contre la Russie. Le Rassemblement National s’oppose aux mesures économiques restrictives, tandis que la coalition NUPES s’érige contre la fourniture d’armements, au nom d’une prétendue logique de désescalade. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer qu’une alternative politique menée par Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon offrirait davantage de stabilité ni de fiabilité aux partenaires européens et à l’OTAN. Un tel scénario représenterait sans nul doute une source de profonde inquiétude pour l’équilibre géopolitique du continent.
L’aveuglement de la presse anglo-saxonne
Quant à la presse anglo-saxonne, elle tend généralement à minimiser les répercussions diplomatiques de l’alliance AUKUS. Elle omet le plus souvent d’établir un lien entre la réorientation de la politique étrangère française et le camouflet infligé à Paris par ses alliés traditionnels. L’analyse qu’elle propose des choix stratégiques de la France est bien souvent empreinte de condescendance, voire de suffisance.
Cette légèreté s’est d’ailleurs illustrée dans une plaisanterie révélatrice : à l’occasion du 1er avril, plusieurs médias anglophones ont relayé une fausse annonce selon laquelle la France allait finalement rejoindre l’AUKUS, rebaptisé pour l’occasion FUKUS — acronyme volontairement grivois, signifiant littéralement « l’avoir dans le baba ». La farce suggérait même qu’une partie de la construction des sous-marins australiens à propulsion nucléaire serait transférée à Cherbourg. Au-delà de l’humour douteux, ce trait satirique trahit un certain mépris à l’égard des intérêts français, et témoigne du peu de sérieux accordé à une fracture diplomatique pourtant majeure.
France joins AUKUS. The security and defence bloc is renamed FUKUS.
— Velina Tchakarova (@vtchakarova) April 1, 2023
ht @CovertShores https://t.co/W6b0OClZic
***BREAKING***
— H I Sutton (@CovertShores) April 1, 2023
France is joining #AUKUS submarine program with Australia, Britain and U.S!
Who is next? https://t.co/Evd5i4HKdZ
- CHRONIQUE D’UNE RÉVOLUTION : UKRAINE 2013-17
- Macron, le Guépard ?
- IMMIGRER AU CANADA – ENTRETIEN AVEC LAURENCE NADEAU
- Français d’Algérie ? Ça commence mal !