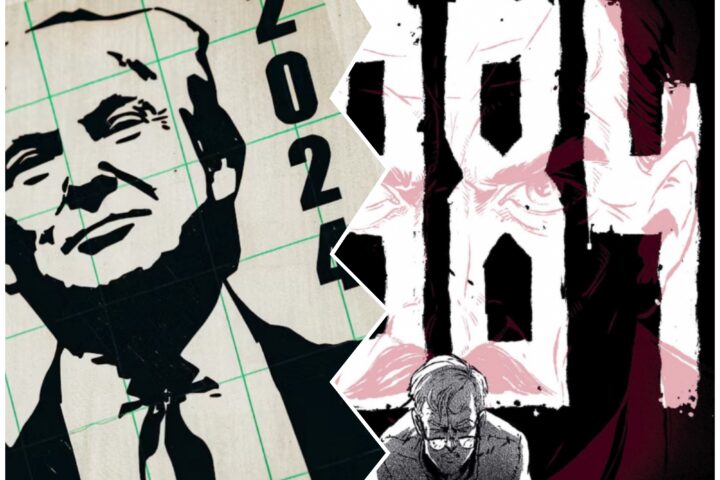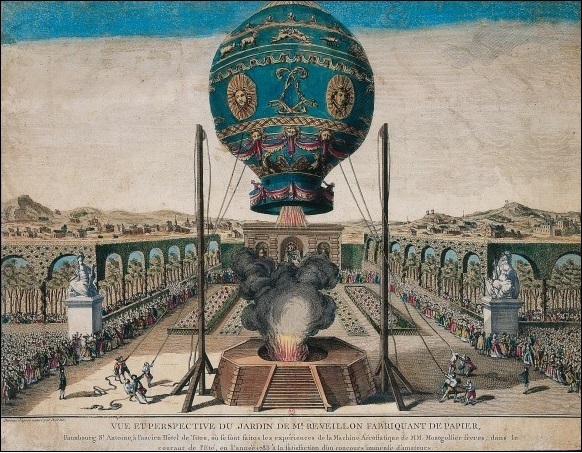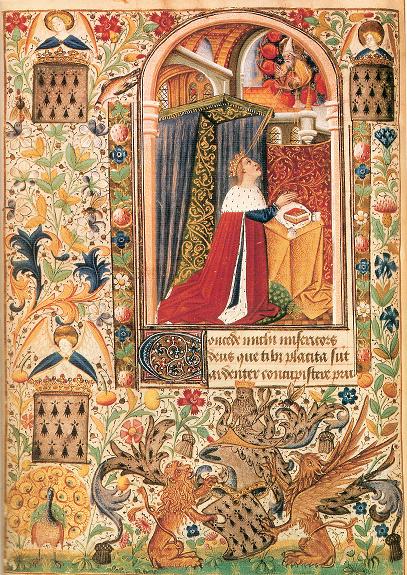Arendt, Camus, leur message de paix au 20e siècle comme un écho aux guerres du 21e siècle
HANNAH ARENDT
« Je n’appartiens à aucun groupe, sauf de 1933 à 1943 à celui des sionistes, mais bien sûr seulement à cause d’Hitler. Ensuite j’ai rompu ». Ainsi s’exprimait Hannah Arendt en 1972 alors qu’elle était interrogée sur ses opinions politiques.Lire et relire Hannah Arendt est plus que jamais nécessaire en 2025 cinquante ans après sa mort. La philosophe juive-allemande a été l’objet de maintes controverses et le demeure en ce premier quart du 21e siècle. Sioniste puis rompant avec le sionisme, femme libre, anticonformiste, quelque fois provocante, elle bouscule encore un prêt à penser confortable et quelques fois paresseux qui nous figerait dans une pensée ou une opinion déterminée par un nom, des frontières, un passeport, voire une couleur de peau ou une religion. Une pensée qui serait essentialisée par un lieu de naissance, une identité unique.En ces temps de nationalisme exacerbé et de poussée religieuse Arendt est un contre feu. En 1947, à peine la deuxième guerre mondiale achevée, elle écrivait à Karl Jasper : « Il vaut mieux ne se sentir chez soi nulle part et ne faire confiance à aucun peuple car il peut à tout moment se transformer en instrument aveugle de la mort. » Pessimisme ou lucidité ? D’après ce qu’elle a vécu dans les années 30 en Allemagne la deuxième option est la plus crédible. Et, ce que nous savons de la deuxième moitié du 20e siècle, au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie … conforte encore cette lucidité.La tentation est de lire Arendt en songeant uniquement à ce qu’a été et ce qu’est aujourd’hui l’État d’Israël. Dans les années 50 déjà, elle envisageait Israël comme un État-Nation puissant et victorieux mais environné d’une population arabe hostile et donc enfermé dans des frontières toujours à défendre dans une sorte de « guerre permanente sans paix possible ». Était-ce une fatalité ?
L’histoire banale d’idéaux qui tournent mal
La radicalisation du conflit entre Israël et la question palestinienne nous renvoie à Hannah Arendt bien sûr. « Elle l’avait prévu » pourrait-on écrire avec une certaine naïveté. De fait, lorsqu’elle décrit la mutation d’idées généreuses en idéologie mortifère elle parle d’Israël mais pas seulement.Dans sa généalogie du sionisme, elle rappelle que ce mouvement est né en Europe centrale au XIXe siècle à la jonction de deux courants de pensée : le socialisme-révolutionnaire venus d’orient et de populations minoritaires soumises à une oppression constante ; et un nationalisme porté par des intellectuels en réaction aux discriminations sociales.Ce « socialo-sionisme » portait un modèle juif de société distant de valeurs strictement matérielles et idéalisant en une synthèse utopique de culture et de travail, une organisation sociale dynamique et heureuse, concrétisée dans les kibboutz des premiers temps. Mais très rapidement les leaders sionistes, nous dit Hannah Arendt, ont pris une autre voie.Une rupture, une révolution, un espoir portés par des idées généreuses qui finissent mal, rien d’original au fond, le conflit du Moyen-Orient n’a rien inventé : il hérite d’histoires successives, notamment celle de l’Europe, à laquelle paradoxalement le sionisme voulait échapper en pensant créer une terre sûre et accueillante pour tous les juifs du monde. Cet objectif n’est pas à ce jour atteint.Deuxième message de la philosophe appliqué à Israël, mais pas seulement : la guerre et le rapport de force permanent ne mènent nulle part sinon à la destruction et à la mort.Très tôt Hannah Arendt a reproché aux sionistes de s’appuyer sur la force et les puissants pour s’imposer plutôt que sur des principes démocratiques et un dialogue avec leurs voisins arabes. Elle s’est séparée des sionistes en estimant qu’Israël plutôt que par une « souveraineté absolue » devait s’intégrer à la région en cherchant une solution adaptée à la géographie et à l’histoire. Elle a même rêvé d’une « fédération » des différents États de la région. Quelle utopie au regard de ce qui se passe aujourd’hui !
Albert Camus
Est-il vain d’en appeler à l’intelligence des hommes ?
La vaine lucidité de Hannah Arendt, trop éloignée sans doute des réalités du monde et des comportements humains, nous renvoie à une autre lucidité, presque à la même époque. Celle d’Albert Camus qui en janvier 1956 moins de deux ans après le début de la guerre d’Algérie, se rend à Alger pour participer à une rencontre entre démocrates et libéraux qui proposaient de tendre la main aux musulmans. Camus en appelait à l’intelligence des hommes pour échapper à l’avenir tragique qui se profilait. Son intervention qui décrit sans ambiguïté les injustices et les désordres liés à la situation coloniale a été conspuée par une partie de l’auditoire. On connait la suite.Au cours de cette rencontre à Alger l’idée de créer une fédération entre la France et l’Algérie pour mettre fin au conflit et éviter dérive meurtrière, terrorisme et attentat, a été soulevée. En vain. Six ans de guerre, de massacre, de torture ont suivi. Les impossibles « fédérations » imaginées par Arendt et Camus, fondées sur une paix désirée et une capacité au dialogue n’ont jamais vu le jour. Dans chacun des cas les nationalismes et les ultras l’emportent ou l’ont emporté.
Où en sommes-nous en 2025 ? L’humanité a-t-elle progressé ?
Les nationalismes l’emportent partout sur la planète, les religions sont de retour, les pires populismes accèdent au pouvoir, les guerres se rapprochent, des villes s’effondrent, les rapports de force s’imposent et la politique régresse. Est-ce une raison pour désespérer ?Hannah Arendt qui se définissait comme politologue plus que comme philosophe nous dit que la politique n’est pas une vérité idéale, que c’est un « bien commun » qui se fabrique sans cesse par le travail et l’action. Camus qu’elle admirait (plus que Sartre dont elle se méfiait) a toujours concilié l’absurde, le tragique et le droit au bonheur. Un bonheur impératif même. Ainsi tous deux ont poussé leur « vaine lucidité » comme Sisyphe son rocher. Alors, comme eux, comme Camus surtout « voyons Sisyphe heureux » et tentons de l’être avec lui.
Didier Levreau