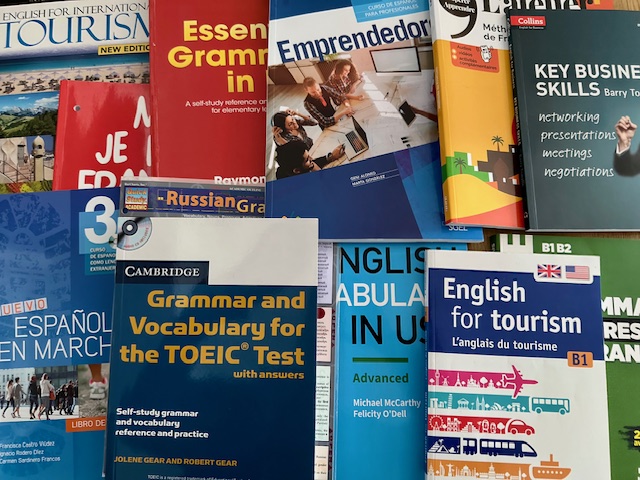Coran
Série: Diogène en banlieue” : Heurs et malheurs d’un prof de philo aux confins du système scolaire.
Auteur: Gilles Pétel
Avec nos remerciements à l'auteur. Texte publié en premier dans délibéré.fr
Si nos élèves sont parfois drôles, ils se montrent aussi quelquefois inquiétants. L’an passé, j’avais été nommé sur deux établissements, l’un général, l’autre professionnel. J’assurais dans ce dernier deux heures de cours hebdomadaires auprès d’une classe technique composée essentiellement de jeunes filles. Leur filière les destinait aux métiers de la santé. Beaucoup d’entre elles désiraient devenir infirmières. Dès les premiers cours, que je ne commençai une nouvelle fois à donner qu’à partir de la fin du mois de septembre, je me heurtai à une classe rétive. Le bavardage était incessant, le comportement des élèves puéril, potache au mieux, régressif parfois. Un jour, une élève m’interrompt pour déclarer qu’elle a envie de pisser. Je la reprends gentiment et lui demande de mieux s’exprimer. Elle renchérit en affirmant qu’elle a la vessie pleine puis se lève et pose une main décidée sur la fermeture Éclair de son jean comme preuve de sa bonne foi. Elle redouble, elle a passé 19 ans. Désarmé, je l’autorise à quitter le cours.
Chaque année je demande à mes élèves de m’indiquer sur une fiche leurs lectures, quelles qu’elles soient, littéraires, philosophiques ou illustrées. Il existe d’excellentes bandes dessinées. Dans cette classe, la plupart des élèves reconnaissent n’avoir rien lu en dehors des quelques extraits d’œuvres que leur professeur de français leur a imposés en classe de première. Mais ils ont déjà oublié les titres de ces livres. L’une d’entre elles pourtant me tend sa fiche avec fierté. Elle a lu le Coran, affirme-t-elle. Je la félicite, car c’est un très beau texte. Ma réponse la désarçonne. L’élève, que j’appellerai Mélanie, perd un peu de sa superbe. Ce n’est pas ce qu’on dit d’habitude, me fait-elle comprendre. Et ce “on” vise à l’évidence les professeurs. Je l’assure de ma bonne foi. Le Coran comme la Bible sont de grands textes, bien que l’un et l’autre soient parfois d’un accès difficile. Je lui demande alors si elle a lu d’autres livres. Mélanie retrouve aussitôt un sourire éloquent. Seul le Coran a toute son attention. Je préfère ne pas insister.
Mélanie n’est ni plus ni moins bavarde que ses camarades, ni plus ni moins agitée. Quand elle ne bavarde pas, elle soupire ; quand elle ne soupire pas, elle s’endort. Elle arbore cependant une tenue distinctive. Elle porte une sorte de robe à manches longues qui lui monte jusqu’au cou et descend en-dessous des chevilles. Mélanie ne quittera pas cet accoutrement de toute l’année, se contentant de changer de couleur à l’occasion. La robe est tantôt verte, tantôt noire. Alors que nous abordons la partie du programme consacrée aux rapports des croyances et de la raison, j’apporte à mes élèves un texte d’Hippocrate extrait de L’Art de la médecine. Le texte évoque ce que les Grecs de l’antiquité appelaient “la maladie sacrée” et que nous appelons aujourd’hui l’épilepsie. Hippocrate y explique en termes très clairs que cette pathologie n’a rien de sacré et qu’elle possède une cause matérielle, à l’instar des autres maladies. Puis il s’en prend ouvertement à ceux qu’il nomme des “charlatans”, “mages, purificateurs, prêtres, mendiants”, parce qu’ils préfèrent cacher leur ignorance derrière le voile de la religion afin de conserver le pouvoir qu’ils exercent sur les esprits. Ce texte est étrangement moderne et ce n’est pas sans intention que je demande à mes élèves de l’étudier. J’attends avec impatience le résultat de leur lecture, qu’elles doivent consigner par écrit. Je passe de rang en rang et constate avec plaisir que beaucoup saisissent l’idée générale du texte. Lors de la discussion qui suivra, je verrai qu’elles la partagent également. Mélanie elle-même me dit approuver la thèse d’Hippocrate. Je regarde ses notes : elles attribuent au fondateur de la médecine une idée exactement opposée à celle qu’il soutient pourtant avec la plus grande fermeté. Selon Mélanie, Dieu possède le pouvoir de rendre les hommes malades. Je tente de lui expliquer son contre-sens en prenant appui sur le texte, mais la jeune fille ne m’écoute déjà plus et regarde par la fenêtre.
À la rentrée de janvier, Mélanie est absente. J’imagine tout d’abord qu’elle sèche le cours pour des raisons que je n’ai pas besoin de chercher loin. Quand je ne la vois pas réapparaître au cours suivant, je décide de me rendre chez le CPE afin d’en apprendre davantage. Peut-être est-elle malade. Mais aucun certificat médical n’est parvenu à l’administration du lycée. Mélanie a pourtant manqué tous les cours de la semaine. Avec mon collègue, nous appelons le père qui affirme sur un ton péremptoire ne pas connaître cette enfant. La mère, que nous contactons ensuite, ne nie pas qu’il s’agisse de sa fille mais c’est pour aussitôt nous accuser d’incompétence lorsque nous lui demandons de justifier l’absence de celle-ci. C’est bien sûr notre faute si son enfant déserte les bancs de l’école. Elle n’a pour sa part aucune explication à nous fournir. Comme nous insistons néanmoins, elle déclare parler peu souvent à sa fille qu’elle ne voit d’ailleurs pas davantage.
Quand Mélanie revient en cours la semaine suivante, sans avoir fourni de justificatif, son attitude a changé. Elle refuse de me regarder lorsque je lui adresse la parole, elle tire fréquemment sur sa robe afin de s’assurer que celle-ci masque bien ses chevilles. Parfois elle tente de remonter le col au-dessus de ses oreilles. Devant un comportement que je juge inquiétant, je choisis de ruser et lui demande si elle ne couve pas une otite quand elle se cache les oreilles ou si elle ne cherche pas à dissimuler un début de psoriasis quand elle rentre les mains sous les manches de sa robe. Peut-être devrait-elle se rendre à l’infirmerie. Mes plaisanteries la contraignent à se redresser : la jeune fille laisse un moment tranquille l’étoffe de sa robe. Lors des cours suivants, je remarque qu’elle est désormais seule à sa table. Sa meilleure camarade, pourtant elle aussi très stricte dans sa manière de s’habiller, s’est éloignée d’elle.
Mélanie parle peu désormais et semble se replier sur elle-même. L’attaque du Bataclan avait eu lieu à peine deux mois auparavant. Les attentats étaient dans toutes les têtes. L’année précédente, le lycée où je donnais ces deux heures de cours avait connu le départ en Syrie d’une de ses élèves. Celle-ci avait d’ailleurs épousé l’un des hommes qui s’était fait sauter au Bataclan. Enfin, mes collègues m’avaient révélé que Mélanie avait été l’une des meilleures amies de cette candidate au “jihad”. C’est muni de ces informations que je me rendis une seconde fois chez le CPE. Celle que j’appelais parfois la jeune fille au Coran m’inquiétait de plus en plus et je ne connaissais pas le moyen de la ramener à la raison. Un professeur n’est ni un psychologue ni un éducateur spécialisé ni enfin un théologien. Le collègue partageait mes craintes, d’autant plus qu’il avait lui-même découvert avec stupéfaction le départ en Syrie de cette élève qu’il avait pourtant suivie tout au long de sa scolarité. Il avait noté les changements survenus dans le comportement de la jeune fille mais n’avait pu anticiper son départ. Comme moi, il s’avouait désarmé.
Je voulus alors savoir s’il n’existait pas une cellule d’écoute, au rectorat ou au ministère, capable d’aider les personnels de l’Éducation nationale confrontés à ce nouveau type de problème. Malgré les attentats, rien de tel, selon lui, n’avait été mis en place. La chose me paraissait invraisemblable. Rentré chez moi, j’appelle le rectorat de mon académie pour confirmer l’information. Après plusieurs essais infructueux, une personne m’explique que ce type d’affaires ne relève pas du rectorat, qui gère les personnels et non les élèves, mais de l’inspection académique. J’appelle donc l’inspection. Au standard, après que j’ai indiqué le motif de mon appel, on me demande aussitôt mon nom, mon prénom, ma qualité, mon établissement d’exercice enfin. Le ton est comminatoire et me surprend. J’apprends toutefois qu’il existe bien une cellule d’écoute avec laquelle on me met en communication sans plus tarder. La personne que j’ai au bout du fil me pose les mêmes questions, nom, fonction, établissement, puis me demande de détailler les raisons qui m’ont conduit à faire ce signalement. Je rappelle les faits. À chaque nouvel élément, la personne s’exclame : “en effet”. L’affaire lui semble sérieuse et elle me remercie de l’avoir contactée. Mon initiative la gêne cependant, car c’est le chef de mon établissement qui aurait dû l’appeler. Je comprends, non seulement à sa remarque mais aussi au ton de sa voix, que j’ai commis une bévue. Ce type de signalement n’est pas du ressort d’un professeur.
Quelques jours plus tard je suis convoqué dans le bureau de mon proviseur. Il a le regard sombre, le visage fatigué. Sans autre forme de procès, il me demande “pourquoi je lui en veux”. Aujourd’hui encore je ne suis pas certain d’avoir réussi à le persuader de ma bonne foi. L’affaire n’eut pas de suite, du moins pas à ma connaissance. Mélanie fut moins souvent absente dans les mois qui suivirent, son attitude se détendit quelque peu. À la fin de l’année elle acceptait de me regarder en face. Cette affaire me laissa cependant un goût amer dans la bouche. Quand le standardiste de l’inspection académique m’avait assailli de questions, j’avais aussitôt compris que j’avais mis le pied dans un engrenage. La personne à qui j’avais parlé ensuite, et qui s’était montrée à la fois très aimable, attentive et très professionnelle, n’avait fait que confirmer mon impression. J’étais entré dans un dispositif policier. Après avoir raccroché, je n’avais pu m’empêcher de penser que le signalement que je venais de faire s’apparentait, de près ou de loin, chacun décidera, à une forme de délation. Sans doute avais-je eu raison de m’inquiéter et d’agir. Si mon appel avait permis d’éviter un départ en Syrie, il était indiscutablement justifié. Mais je pouvais aussi m’être trompé, non pas du tout au tout, mais du moins en partie. Et alors de quel droit allais-je dénoncer à l’autorité publique les égarements d’une gamine ?
Il n’existe pas, je crois, de solution satisfaisante au dilemme devant lequel je me trouvais. Mais il me semble utile de souligner que mon appel n’allait pas de soi. Certains jugeront mes scrupules excessifs. Je rappellerai que notre histoire fourmille de gens qui se montrèrent un peu trop zélés quand on leur demanda de faire ce qui ne s’appelait pas encore un “signalement”. Peu de temps après, je racontai “l’affaire” au proviseur du second établissement où j’exerçais. Je voulais savoir ce qu’il en pensait. Il s’étonna de mon ignorance. Chacun connaissait, selon lui, l’existence de cette cellule d’écoute. Les jours suivants, j’interrogeai mes collègues. Aucun d’eux n’avait entendu parler de la fameuse cellule. Pugnace, je revins à la charge auprès de mon chef d’établissement. Il me congédia rapidement en me rappelant que ce genre de problème était de son ressort et non de celui des professeurs. Mais ne sommes-nous pas, nous autres professeurs, précisément les mieux placés pour observer les dérives de nos élèves ?
FΩRMIdea Paris, le 17 décembre 2016.
Dans la série Diogène en Banlieue, lire : 1. Invasion2. Affectation3. Métier4. Coran5. Contact
Chromique de Gilles Pétel 
FΩRMIdea
News: facebook.com/formidea
Arts & Wisdom: facebook.com/newsformidea