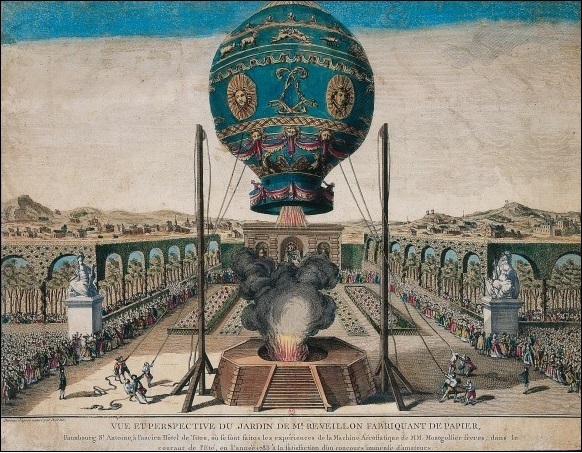De l’Empire ottoman au Congo belge, la tragique ADN familiale des Rossos
Auteur : Rinaldo Tomaselli
CONTEXTE : L’ÉPIRE ET SA POPULATION
L’Épire est une région montagneuse aux confins de la Grèce, de la Macédoine et de l’Albanie. La mer Ionienne délimite le territoire à l’Ouest.A toutes les époques l’Épire a eu des envahisseurs qui ne venaient pas y chercher la richesse, mais une position stratégique permettant de contrôler le passage entre les Balkans et l’Italie, à l’entrée de la mer Adriatique. Ainsi, au cours des siècles, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Catalans, les Slaves et les Ottomans avaient dévasté toute la région. Même au XXe siècle, ce sont des nations modernes qui se sont disputées à leur tour ces terres, annexant totalement ou partiellement le territoire et laissant des vallées dévastées après leur retrait. Ainsi Albanais et Grecs se sont affrontés, puis les Italiens, les Serbes, les Français et les Austro-hongrois.
Les TurcsA la fin du XIXe siècle, toute la région appartenait encore à l’Empire ottoman et formait le vilayet (province) d’Ioannina. A l’image du reste de l’empire, la population n’était pas homogène et on y parlait une demi-douzaine de langues. Les Turcs avaient le pouvoir, mais restaient très minoritaires. Ils vivaient essentiellement dans les villes et les bourgs et étaient constitués de familles de fonctionnaires dont certaines étaient installées depuis plusieurs siècles. Une petite communauté turcophone était également présente dans le nord-est de l’Épire, près de la Macédoine : des nomades musulmans appelés « Yörük ». Ils partageaient les terres les plus arides de la province avec les Karakachans, d’autres nomades certainement d’origine turco-petchenègue, chrétiens qui furent progressivement hellénisés.
Les AlbanaisLes Albanais étaient nombreux sur tout le territoire. Ils étaient divisés en deux groupes distincts parlant à peu près les mêmes dialectes. Les Arvanites étaient orthodoxes, tandis que les Tsamides étaient musulmans. Pendant la période ottomane, les orthodoxes étaient scolarisés en grec et les musulmans en turco-ottoman, tandis que leur propre langue s’écrivait en caractères latins. Ils furent les uns comme les autres très imprégnés par les deux cultures dominantes.
Les Grecs et les LatinsLes Hellènes étaient les plus nombreux, surtout concentrés le long de la côte, en plus petit nombre à l’intérieur des terres.Plusieurs vallées comptaient une population latine importante. Les Valaques ou Aroumains, étaient répartis dans tous les Balkans, de l’Istrie à la Turquie, mais ne formaient nulle part une majorité qui aurait pu s’imposer. Ils partageaient ainsi leur sort autant que leur aire de peuplement avec les Égypto-balkaniques, une communauté venue d’Égypte certainement à l’époque d’Alexandre-le-Grand.
Communautés juivesDans les villes et les bourgs de l’Épire ottomane vivaient de petites communautés juives depuis des temps très reculés. A l’origine, il s’agissait de Romaniotes (Juifs de langue grecque), mais après l’arrivée en masse des réfugiés juifs d’Espagne à partir de 1492, c’était la langue espagnole (dialecte ladino) qui dominait le judaïsme épirote. Une seule communauté juive hellénophone existait encore à Ioannina.
Les TziganesEnfin, les Tziganes constituaient un groupe important dispersé un peu partout dans l’Épire, mais étaient plus concentrés et sédentarisés au nord-ouest du territoire et sur la côte. Eux aussi étaient divisés religieusement entre islam et orthodoxie.
Si d’une manière générale tous ces groupes vivaient assez harmonieusement, cependant des conflits, des querelles de voisinages ou carrément des révolutions contre le pouvoir ottoman n’étaient pas inexistants. Souvent, l’origine d’une confrontation partait d’une simple dispute ou de larcins commis par les uns envers les autres.
FUITE DE YORGOS ROSSOS VERS CONSTANTINOPLE
C’est le cas en 1879 lorsque Yorgos Rossos décide de se rendre dans les pâturages au-dessus de son village hellène, afin de guetter des Albanais qui viennent depuis plusieurs nuits dérober des chèvres de son troupeau. Quelques amis l’accompagnent, tous armés de gourdins, question de faire passer l’envie de chaparder à ces Albanais. Quand ces derniers arrivent tard dans la soirée, les Grecs leur tombent dessus et s’en suit une violente bagarre entre les deux groupes. Yorgos frappe un Albanais de son bâton et celui-ci perd l’équilibre, tombe à la renverse et se cogne la tête sur une grosse pierre.Etalé sur l’herbe, l’Albanais n’a qu’une petite blessure à la tête, mais il ne respire plus. Yorgos reste figé par ce spectacle. Certes, il a souhaité donner une leçon aux Albanais, mais il ne voulait pas en arriver là. Il n’est pas un meurtrier et aurait cédé facilement quelques chèvres plutôt que de tuer un homme qui avait à peu près son âge. Mais comment expliquer à la police ottomane qu’il s’agit d’un accident ? Il sera pendu, ça ne fait aucun doute.Le seul moyen d’échapper à la potence est de s’enfuir immédiatement loin du village et loin du lieu du drame. Il retourne chez lui, emballe quelques affaires et s’en va à pied dans les montagnes en direction de la Macédoine, première étape avant de continuer son long voyage jusqu’à la capitale. Il compte retrouver de la famille éloignée qui pourra l’aider à recommencer une autre vie dans l’anonymat de la grande ville. Yorgos n’a que 21 ans, mais il est plein de courage et d’espoir.
Il se marie quelques années plus tard avec une jeune grecque de Constantinople. Ils vivent dans le quartier de Phanar (Fener), sur la Corne d’Or et par la suite ont cinq enfants. Yorgos a un petit magasin de tissus au Grand Bazar.L’ainé des enfants porte le même prénom que son père, comme le veut la tradition familiale. Celui-ci fait des études, se marie et de cette union naîtront quatre enfants. Yorgos fils possède une pharmacie dans le quartier levantin de Péra, sur la place de Galatasaray. Les bouleversements politiques dans l’Empire ottoman à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe n’atteignent pas directement la famille qui a encore un niveau de vie un peu au-dessus de la moyenne, même après la Première Guerre mondiale. L’Épire, leur terre d’origine, est annexée par le Royaume de Grèce lors de la Première Guerre balkanique (1912). Il n’a cependant jamais été question d’y retourner, la région est peut-être libérée du joug ottoman, mais elle reste d’une pauvreté extrême, ce qui a d’ailleurs provoqué une émigration vers la capitale ottomane des musulmans comme des chrétiens.En 1922, quand s’achève la guerre gréco-turque à l’avantage d’Atatürk, Yorgos fils ne voit pas l’avenir d’un bon œil et hésite à vendre sa pharmacie et à s’en aller avec sa famille en Australie. Il lui manque toutefois un peu de courage pour redémarrer une autre vie en terre inconnue, et puis son épouse Elena n’y est pas favorable.
VOYAGE EN AFRIQUE
Yorgos encourage alors ses deux enfants les plus âgés à partir. Il avait trois filles et un garçon (Yorgos petit-fils). Celui-ci n’a que 19 ans et est amoureux d’Ifigenia, une Smyrniote de 17 ans qui s’est réfugiée à Istanbul, juste avant qu’Izmir ne soit abandonnée par l’armée grecque.Ifigenia vient d’une famille aisée de négociants d’Izmir. Elle a reçu une bonne éducation en français et en anglais. Elle parle également l’italien, le turc et naturellement le grec, sa langue maternelle. Elle a de la famille installée à Athènes et à Nice, mais la Grèce et la France sont ravagées économiquement par des années de guerre. La perspective de quitter Istanbul pour rejoindre l’un ou l’autre de ces pays n’enchante guère Ifigenia.Un cousin éloigné de son père s’est installé en Afrique au début du XXe siècle, dans une province qui était alors tenue par les Ottomans, sous le contrôle de l’armée égyptienne. Le chef-lieu Djouba (capitale aujourd’hui du Soudan du Sud) est entre-temps devenu possession britannique, mais une communauté grecque y vit toujours. D’autres Grecs ottomans se sont installés plus au Sud, au Congo belge. Les nouvelles qui parviennent de cette communauté font état d’une colonie prospère et bien acceptée par le gouvernement et la population belge.Yorgos, petit-fils de Yorgos d’Épire, décide avec Ifigenia d’embarquer pour l’Afrique. Ils ont tous les deux assez d’argent grâce à leur famille respective pour entreprendre le voyage et pour vivre les premiers mois de leur future installation. Ils savent que dès qu’ils auront passé la frontière ottomane, ils n’auront plus la possibilité de revenir en arrière, mais ils partent quand même, en traversant des contrées ravagées par la guerre en Anatolie. Dans la région de Marmaris, ils paient un pêcheur grec pour les emmener clandestinement sur l’île de Rhodes, alors possession italienne.Ils ont entendu parler à Istanbul d’une filière qui faisait passer des Grecs, mais surtout des Juifs ottomans, depuis l’île de Rhodes à la colonie belge du Congo. Ils comptent donc utiliser cette filière jusqu’à Djouba et y retrouver le lointain cousin.
La ville de Rhodes est envahie de réfugiés grecs d’Anatolie. La plupart cherchent à émigrer plus loin, soit vers l’Europe occidentale, soit vers les États-Unis. Les autorités italiennes paraissent débordées et ferment les yeux sur la validité des documents qui leur sont présentés. Les rues sont pleines de pauvres gens qui attendent qu’on les prenne en charge ou qu’on les évacue vers la Grèce. Ceux qui ont un peu d’argent cherchent des passeurs ou des employés d’administration à soudoyer.Yorgos et Ifigenia se rapprochent de la synagogue afin de trouver un responsable s’occupant des gens désireux de se rendre au Congo. Non sans mal, ils sont acceptés pour rejoindre un petit groupe de Juifs et de Grecs ottomans qui s’embarquent pour Alexandrie. De là, ils remontent le Nil. Ainsi ils pourront aller jusqu’à Djouba.

Leur arrivée au début de l’année 1923 n’est pas réjouissante. La ville n’est en fait qu’un gros village bâti à la hâte et peuplé de commerçants grecs ottomans fraîchement arrivés. Une garnison anglaise se trouve à proximité, mais la majorité des habitants sont hellènes. Ifigenia, lors de son long et pénible voyage se fabriquait des images d’un petit Istanbul au bord du Nil. Elle se voyait déjà dans une taverne à déguster les mézès au son de la rembetika. Dure réalité, elle débarque dans un village à peine construit, sans restaurant ni boutique, avec des rues boueuses au milieu de nulle part.Tous les sacrifices qu’elle a faits au travers de la guerre – l’abandon d’Izmir, puis d’Istanbul et de sa famille – ont certes servi à sauver sa peau, mais si elle avait rêvé d’une vie meilleure, elle ne l’envisageait pas un instant dans cet endroit désolé. Dès son premier regard sur Djouba, elle songe au moyen de quitter ce trou perdu.