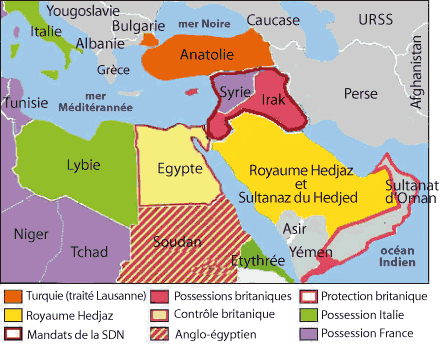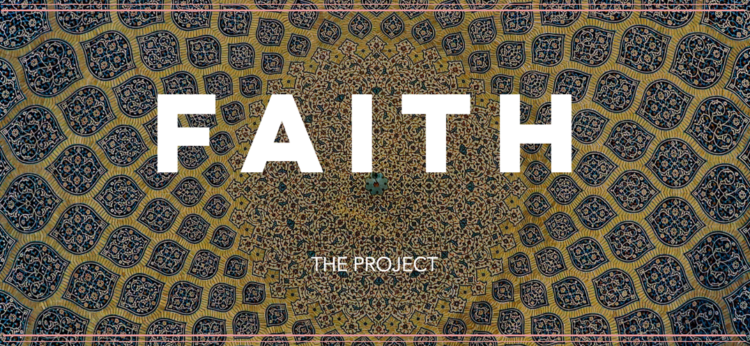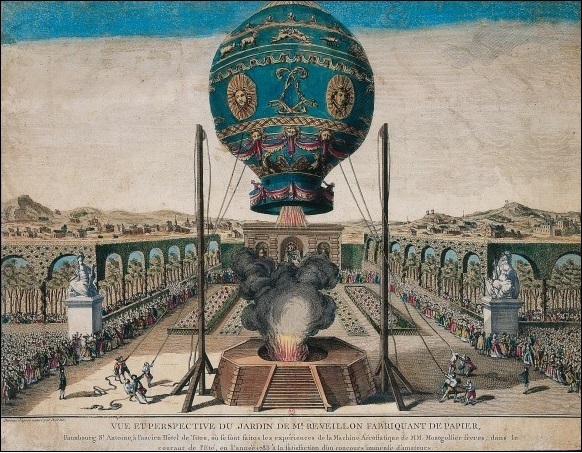Les Assyriens & le génocide oublié
Auteur: Fred Daudon
TUR ABDIN, LE DERNIER TOMBEAU DES « SERVITEURS DE DIEU »
Un soleil rasant de début de printemps illuminait les rares cultures de la plaine mésopotamienne. La Syrie s’étalait en contrebas de Mardin. La trêve semblait respectée : pas de fumée, pas de frappe aérienne, un silence presque apaisant au regard de la situation en Turquie. En arrivant de Gaziantep la veille, j’étais passé par Diyarbakir, encerclée, asphyxiée par un mois d’état de siège et de guérilla. Impossible de pénétrer dans la ville sans laisser-passer des autorités turques. A la télévision, les images de l’armée turque pilonnant la région montagneuse entre Mardin et Midyat tournent en boucle. D’autres montrent des batailles de rue qui n’ont rien à envier à celles qui se passent de l’autre côté de la frontière. Sur la route, je ne croise que barrages de l’armée et rondes de blindés. Des regards anxieux de jeunes soldats blottis derrière leurs sacs de sable m’interrogent. La situation est tendue depuis la reprise du conflit armé dans les régions à majorité kurde de la Turquie.
« Bienvenue à Tur Abdin et à Mardin, un de ses sites les plus spectaculaires » me lance une plaquette publicitaire. Mustafa, le gérant de l’hôtel ne décolère pas. Il regarde au loin, vers la Haute-Mésopotamie. Mustafa, comme la majorité des Kurdes de la région est sunnite chaféiste, école qui prône un suivi rigoriste de la liturgie musulmane. « Marre de ces guerres, souffle-t-il. » Les rares touristes en cette saison ont été remplacés par les journalistes étrangers. « Tu vois ce château ? me demande-t-il », en désignant la forteresse qui surplombe l’ancienne ville de Mardin, « je n’ai pu le visiter que deux fois avec l’école, il est toujours occupé par l’armée. Aucun touriste n’y a jamais mis les pieds. » Il m’informe que le matin même un Kurde a été tué à un barrage policier au sud de Mardin. Ces scènes se succèdent jour après jour depuis une parenthèse de paix relative qui aura duré cinq ans. Les bombardements succèdent aux attentats à Istanbul, Ankara, Diyarbakir, Batman, Mardin et Midyat.
Tur Abdin, « la Montagne des serviteurs de Dieu » en syriaque, n’est plus qu’un champ de bataille sans fin. Ce plateau s’étend le long de la frontière turco-syrienne sur plus de 100 kilomètres de large pour une surface d’environ 4 000 km2, un territoire aussi grand que la Haute-Savoie. C’est ici entre les sources du Tigre et de l’Euphrate que se joue l’avenir des premiers chrétiens d’Orient, pris dans un étau, entre armée turque et kurdes. Entre les deux mors, la population syriaque résiste mais pendant encore combien de temps ? Les chiffres divergent entre les autorités turques et l’Organisation des Nations et des Peuples non Représentés. Toutefois, en gardant une certaine prudence, nous pouvons avancer que les Syriaques étaient entre 500 000 et un million d’individus en Turquie jusqu’aux exactions qui commencèrent fin du XIXème siècle, début XXème. Selon les comptes avancés par Sébastien de Courtois, ils étaient plus de 50 000 avant la première Guerre Mondiale dans la seule province de Mardin puis 20 à 25 000 dans les années 70. Ils sont maintenant 1500 individus sur le plateau de Tur Abdin.
Mardin, l’ancienne capitale de l’Eglise Syriaque
Je rencontre par hasard dans les ruelles de la vieille ville de Mardin, une femme qui me demande de la suivre chez elle. Maryam est syriaque. Au mur, des photos des patriarches de l’Eglise succèdent aux scènes liturgiques et aux photos de famille. Elle me propose d’acheter un tableau de la Cène qu’elle a réalisé en point de croix. Nous discutons. « Mon mari est décédé d’une longue maladie, mon fils est au chômage car personne ne veut embaucher un gâvur (ndlr : mot utilisé en Turquie pour désigner les non musulmans et que l’on peut traduire par « infidèle » ou « mécréant ») », me dit-elle. « Mes parents ont eu la vie dure, j’ai eu une vie dure et mon fils a la vie dure. J’aurais pu choisir de partir comme la majorité de la ville, mais c’est ici d’où je viens, où j’ai grandi, dans cette maison, continue-t-elle. » Je remarque une peinture sur tissu détaillant un Christ sur la Croix. Le style est naïf et reconnaissable entre mille. Il s’agit d’une des œuvres de Nasra Hanım, une dame très âgée descendante de la dernière famille pratiquant cet art millénaire. Elle est une grande personnalité locale et une vedette dans la communauté syriaque. Impossible malheureusement de la rencontrer aujourd’hui, une fièvre la cloue au lit. Barsam, le fils de Maryam, arrive dans le salon. Il m’invite à visiter la ville avec lui. Nous déambulons dans les ruelles étroites de la vieille ville. « Nous sommes encore une centaine de familles syriaques à vivre à Mardin mais la plupart sont des personnes âgées, m’avoue-t-il. Les jeunes sont partis faire des études ailleurs dans le pays et ne reviennent pas. Je les comprends, ici, il n’y a pas de travail et c'est la guerre depuis plus de 30 ans. » Nous passons d’église en église, toutes datant de plusieurs siècles. « Elles ont été construites bien avant l’arrivée des Seldjoukides, des Tatars, des Turcs, de Tamerlan et autres envahisseurs, confirme-t-il. » Cependant, d’après Elif Keser Kayaalp, spécialiste de l’architecture syriaque, une trentaine d’églises et monastères de Tur Abdin ont été construits entre la fin du VIIe et le début du VIIIe siècles, donc après la conquête arabe de la région. « Nous avons vécu sous domination omeyyade, puis ottomane, dans la paix et dans le respect. En un siècle, tout a été détruit. Aujourd’hui, à qui pouvons-nous faire confiance ? A la République Turque qui nous ne nous a jamais considérés ? Aux Kurdes qui ont pris nos terres et ont participé au massacre de notre communauté ? A l’Occident qui ne nous a jamais aidés ? ». Barsam est amer. Il reste encore huit églises en activité dans Mardin dont quatre syriaque, une protestante anglicane, une arménienne orthodoxe, une chaldéenne et une catholique. Il accélère le pas, il veut absolument me montrer deux autres églises. L’une, Mor Smuni, n’est maintenant ouverte que pour les messes, « pour éviter les dégradations, me confie-t-il ». Le guide hurle dans la rue. Soudain quelqu’un arrive, il nous ouvre et repart. Les cours se succèdent comme suspendues les unes aux autres. Quelques voûtes présentent des sculptures aux motifs de fleurs, de pétales et de cercles entrelacés. Des tombes sont alignées vers le levant. Le lieu résume à lui seul la situation des Syriaques, celui d’une disparition lente dans un cadre somptueux.
Nous partons vers la seconde église, Mor Mihail. Là, des champs d’oliviers bordent l’église, tout aussi bien conservée que les autres. Une famille turque pique-nique devant le portail rouillé. Nous essayons de pénétrer, des dindes agressives et voulant en découdre nous barrent la route, sous le regard amusé du chien « féroce » normalement en poste. A défaut de clé et de gardien, nous rebroussons chemin. A toute chose malheur est bon. Quelques minutes après, nous pénétrons dans une maison qui d’extérieur ressemble à toutes les autres. Deux heurtoirs ornent les épaisses portes en bois des maisons syriaques, deux cercles liés, symboles de Dieu et de la Terre. Nous sommes accueillis par un enfant, le fils de Barsam. Sa femme nous conduit à une porte donnant sur la cour intérieure. Des bouteilles plastiques vides et une paire de bottes s’amoncellent devant l’entrée. Derrière cette porte se cache un trésor. Une chapelle. Les murs blancs sont défraichis et soutiennent tant bien que mal de très vieilles peintures sur tissu et autres reliquaires. Un sanctuaire du peuple syriaque conservé à l’abri du monde extérieur. On se croirait dans une capsule, on s’imagine une grande famille venant prier avant leur dîner, les enfants riant dans la cour, l’endroit rempli dans un silence de méditations. Le lieu est maintenant vide. Ne restent que les souvenirs d’un temps révolu.
Le tour se termine devant le musée de Mardin. Le musée a ouvert récemment dans d’anciens bâtiments militaires, sous le patronage d’un riche entrepreneur né à Mardin. Une enfilade de métiers disparus, d’habits traditionnels et de photos sepia emplissent l’air de ce que devait être Mardin avant, une atmosphère cosmopolite et enjouée où les costumes, la musique et les langues s’entremêlaient. Une télévision passe en boucle les souvenirs et les témoignages des apatrides syriaques. Ils viennent d’Australie, des Etats-Unis, d’Allemagne, de Suède, du Canada, de France, de Suisse et de bien d’autres pays. Il renforce un malaise qui devient omniprésent, celui de personnes si attachées à leur terre et dépitées, sans armes pour la préserver, la laissant mourir à petit feu.
La récente visite du Pape François en Arménie était l’occasion rêvée d’attirer l’attention des médias sur un génocide concomitant celui des Arméniens, suivi d’une longue période de persécutions jusqu’à aujourd’hui. Il s’est pourtant tu. Aucun mot pour ses coreligionnaires, eux aussi descendants de l’Eglise d’Antioche.
Près d’un siècle après les faits, les historiens commencent à avoir une vision plus précise des exactions massives commises à l’époque par les kurdes aidés par les Jeunes Turcs.
Seyfo, le génocide oublié
1915, Shato d’seyfo, « l’année de l’épée » comme les syriaques la nomment. Une année noire durant laquelle la moitié du peuple assyrien va être exterminée ou déportée.
Les massacres de masse ont déjà débuté 20 ans auparavant, à Diyarbakir et dans les villages alentour. 55 000 syriaques sont tués, convertis de force ; Des femmes sont envoyées dans les harems. Les Assyriens sont les victimes de la réponse du sultan Abdülhamid II à une rébellion arménienne débutée en 1894.
En 1914, l’Empire Ottoman rejoint la Triple-Alliance. Les Britanniques cherchent à allumer des contre-feux à l’intérieur de l’empire ottoman et passent des accords avec les minorités chrétiennes en leur promettant leurs propres territoires à la fin du conflit. La couronne voulait notamment s’assurer d’un contrôle futur sur la région pétrolifère de Mossoul. Fin 1914, les troupes russes se retirent de la Perse.
Début 1915, deux divisions ottomanes appuyées par des milices kurdes envahissent la région de l’Azerbaïdjan Occidental en Iran. Autour d’Ourmia, les exactions commencent. L’armée turque prend en otage 61 syriaques dans la mission française locale et exige une rançon. Faute de réunir la somme demandée, 20 otages seulement sont libérés, les autres exécutés et décapités. Parmi les victimes se trouvait l’évêque Mar Dinkha. Les syriaques des villages de Gulpashan et Salamas sont fusillés malgré la protection qu'ils ont reçue des autres villageois, azéris et arabes. Dans la province de Diyarbakir, les atrocités recommencent et se propagent aux provinces de Van, Siirt, Mardin, Batman, Sirnak et Hakkari. Le « bataillon des bouchers » qui reçoit directement ses ordres des Jeunes Turcs alors au pouvoir, ordonne le massacre de 20 000 assyriens dans la seule province de Siirt.
La résistance s’organise, notamment sur le plateau de Tur Abdin à Gülgöze, où pendant 60 jours, 22 000 Assyriens vont lutter contre les assauts des milices kurdes locales. En 1916, l’armée assyrienne du général Agha Petros reprend Mossoul aux forces ottomanes, assurant aux Britanniques le contrôle de la zone après la guerre.
Malgré la protection des chrétiens par certains musulmans, l’horreur se poursuivra. A la fin de la guerre, au moins la moitié des communautés assyrienne et arménienne a été exécutée ou déportée. Début 1918, les Assyriens continuent de fuir les régions méridionales de la Turquie pour s’établir en Syrie, en Iran et en Irak. Au printemps, le patriarche de l’Eglise apostolique assyrienne de l’Orient, Mar Simon XIX Benjamin est assassiné par le chef kurde Agha Ismail Simko en Iran. A Khoy, peu après leur arrivée, la presque totalité des 3 500 Assyriens sont tués après un déchainement de sévices corporels et autres tortures par les troupes kurdes de l’armée ottomane.
La cour martiale instituée par la future Turquie après 1918 condamnera à mort les inculpés, tous faisant partie du mouvement des Jeunes Turcs. Dans son réquisitoire, l’avocat général ne laisse aucun doute sur « l’extermination d’un peuple entier constituant une communauté distincte ».
A 5 kilomètres de Mardin, le Métropolite Saliba Özmen fait les comptes dans le monastère de Deyrul Zafran. « Sur l’ensemble des monastères et églises syriaques qui existaient sur le plateau de Tur Abdin avant le XXème siècle, il en reste moins d’1% actifs. Les autres ont été détruits ou transformés en mosquées. »
La majorité des survivants a fui les persécutions pour se réfugier en Syrie (à Al-Quamishli notamment), en Europe et aux Etats-Unis. L’église chrétienne compte encore quelques 50.000 fidèles en Turquie, la plupart (Arméniens et Grecs) ont migré à la signature du Traité de Lausanne.
Le prélat se présente volontiers comme le défenseur d’un des derniers bastions chrétiens de la région, qui fut une de ces premières terres de propagation.
« J’espère que la barbarie enfantée par ISIS sera autant le terreau d’un rassemblement chrétien dans la zone, me dit-il. » Finies les dissensions historiques, l’heure est à l’unité chrétienne, comme en témoignent les dernières rencontres inter-patriarcales et inter-églises à Istanbul en fin d’année dernière. « Bien entendu, nous avons des différences mais il faut surtout rappeler que nous avons un amour commun : le Christ. Il est plus que jamais l’heure de se serrer les coudes et de se réunir. »
« En attendant, continue-t-il, je dois défendre le patrimoine qui est le nôtre et qui appartient à l’humanité. Si je ne fais pas de messe dans une église pendant un certain temps, les autorités la déclarent abandonnée et la convertissent en mosquée. Alors j’occupe le terrain et je change d’église toutes les semaines pour la messe dominicale. » Le Métropolite a gagné une autre victoire à la Pyrrhus, l’ouverture d’une chaire de syriaque, cette langue vernaculaire, néo-araméenne, proche de celle que parlait Jesus Christ. « Le syriaque est une langue qui se transmet et s’apprend lors des cérémonies et des études religieuses. Tant que nous n’aurons pas le droit d’ouvrir notre propre école théologique, le syriaque continuera de péricliter, avertit-il. »
« Après deux générations qui ont vécu en exil, on observe une assimilation des cultures des pays d’accueil et un oubli progressif des traditions, de la liturgie et favorisant l’émergence du turoyo, le « syriaque vulgaire », indique le professeur Ahmet Tasgin, docteur à l’université de Konya et spécialiste des questions religieuses au Kurdistan. Sans langue, comment conserver une identité ?
Sous couvert d’anonymat, certains syriaques sont plus vindicatifs : « depuis un siècle, la Diyanet nous vole nos églises pour les convertir en mosquées, et certains kurdes spolient nos terres pour faire paître leur bétail. Le gouvernement change le nom de nos villages en turc pour faire table rase du passé, notre passé. Voilà la triste réalité, sous le regard complice des autorités et de la justice turques. Il faudra réagir si l’on ne veut pas disparaître. » Justice turque qui coup sur coup a donné raison en 2012 aux maires kurdes de deux villages jouxtant le monastère de Mor Gabriel et à l’administration fiscale et au ministère des Eaux et Forêts. Bien que propriétaire depuis le IVe siècle s’acquitte d’impôts fonciers sur ces terrains depuis 1937, le monastère a perdu la bataille. Difficile de lutter contre une épée de Damoclès qui a déjà tant œuvré pour la disparition de cette communauté.
Les oubliés des traités de paix
Une communauté qui aura déjà vécu sous différents jougs, sans jamais être réellement inquiétée. Jadis, son statut de dhimmi la protégeait dans la société musulmane. La loi islamique lui accordait, en l’échange d’un impôt, une liberté de culte et de commerce cependant restreintes par quelques interdictions comme celle de construire de nouveaux édifices religieux. L’ordonnance de 1856 du sultan Abdul-Medjid I proclame une liberté totale de culte, une égalité de tout sujet de l’Empire devant la justice et l’accès aux emplois publics tout en interdisant toute discrimination d’ordre religieux, linguistique et ethnique.
La dislocation de l’Empire Ottoman va modifier ce climat de paix et de respect mutuel. L’Occident, Grande-Bretagne et France en tête, a largement contribué à la situation que le Proche-Orient connaît aujourd’hui. La fin de l’Empire Ottoman s’est réglée dès 1916 avec une règle et un crayon papier, premier (raté) d’une tentative de définition de frontières. Des accords Sykes-Picot au traité de Lausanne, ces cadres deviendront le terreau fertile de l’ensemble des conflits armés du Moyen-Orient du XXe. François-Georges Picot était le grand-oncle du président Valérie Giscard d’Estaing. L’incapacité notoire de rédiger des traités qui ont du sens serait-elle génétique ?
Finalement pourquoi devrait-on prendre en considération des desiderate personnels. Les habitants d’Azekh, en Turquie, avaient l’habitude de se rendre à Pechabour sur le Tigre, en Irak, par le chemin le plus court, au travers du Djebel... Très bien, ils passeront désormais la frontière ! Au-delà de cette anecdote, comme le souligne très bien Sébastien de Courtois, « les limites des nouveaux États nations ont affaibli l’élément chrétien le forçant à une forme de sédentarité et à une concentration dans les centres urbains. »
La vision économique a pris le pas sur le bon sens, celui de protéger les communautés auxquelles les anglais ont fait miroiter une indépendance après la première guerre mondiale en échange de leur soutien. A la place, des pays de synthèse ont vu jour, mélangeant confessions, tribus et systèmes différents. Les compromis passés sont devenus des guillotines et Kurdes, Syriaques et autres peuples minoritaires se sont fait massacrer sous nos yeux. Le principal souci d’alors était de protéger les puits de pétrole d’Irak et le canal de Suez.
En 1923, malgré la présence d’Agha Petros à la table des négociations à Lausanne, les alliés britanniques et français lâchent du lest. Il n’est plus question de créer une grande Arménie, ni de donner l’autonomie au Kurdistan turc. Seuls les Grecs, les Arméniens et les Juifs sont cités et obtiennent le droit de pratiquer librement leur religion. Les Assyriens sont les grands perdants, non seulement ils ne constituent pas une minorité « reconnue » mais il reste sous le joug de la Turquie dans des régions maintenant à majorité kurde. Le traité institue également des échanges de populations obligatoires entre la Turquie et la Grèce. Les Assyriens se retrouvent seuls et sans droits.
Déplacés ou déportés pendant la guerre en dehors de Turquie, les chrétiens ne sont pas autorisés à revenir. Ils s’implantent alors dans les pays limitrophes : Syrie, Irak et Liban. Pour éviter toute guerre d’indépendance, les autorités d’Ankara démilitarise la région du sud de la Turquie. Les kurdes se révoltent pendant trois ans, jusqu’en 1928, des monastères et des villages chrétiens sont pillés. La situation s’apaise progressivement jusqu’au début des années 60. Puis les vols de bétail, les injures, les crimes recommencent. La situation en Turquie dégénère, de coup d’Etat en coup d’Etat. La majorité des Syriaques choisissent l’exil. « Le peuple syriaque a vécu une diaspora, tant et si bien qu’ils sont maintenant 400 000 à l’étranger contre 30 000 en Turquie » , commente le Métropolite. A partir de 1985 et les débuts de l’action armée du PKK, les Syriaques se retrouvent pris en étau entre l’armée qui les accuse d’aider les combattants kurdes et les Kurdes de soutenir les forces loyalistes.
La région passe sous état d’urgence, des villages entiers sont évacués. Les forces spéciales du JITEM, créées spécialement par le gouvernement turc pour lutter clandestinement contre le PKK, n’hésitent pas à faire régner la terreur. Une trentaine de chrétiens sont assassinés dans les années 90. Depuis la situation reste tendue, comme en témoigne les multiples escarmouches entre armée et miliciens kurdes.
La Turquie a un intérêt vital à apaiser la région : le président Erdogan l’a inclus dans son plan de transformation économique du pays.
Une région stratégique, entre eaux, pétrole et tourisme
Bordant le nord de la Mésopotamie, le plateau de Tur Abdin et les provinces avoisinantes ont toujours été traversés par de nombreuses routes commerciales, sur un axe Nord-Sud, vers la Syrie, et Est-Ouest, vers l’Anatolie et l’Iran. Sur le Tigre, des radeaux étaient utilisées pour transporter les marchandises. A côté des activités agricoles, un commerce d’artisanat se développa, notamment l’orfèvrerie, avec une certaine réussite des populations chrétiennes dans ce domaine.
Afin d’intégrer un peu plus les régions kurdes dans la Turquie, un projet d’ampleur, GAP, est initié dans les années 70. Celui-ci consiste en la création de 22 barrages sur les cours de l’Euphrate et du Tigre et de leurs affluents. Il ne s’agit pas uniquement de production électrique mais d’améliorer les rendements agricoles et de développer des infrastructures et des industries locales.
A Mardin, Mustafa me montre un village dans la vallée en contrebas. « C’est à côté qu’un nouvel aéroport international doit voir le jour. La région est d’une richesse historique exceptionnelle. Erdogan veut en faire la nouvelle Cappadoce. »
Autant de nouveaux obstacles pour les tribus semi-nomades et pastorales qui étaient encore nombreuses à la fin du XXe siècle dans la région. « L’idée du gouvernement est claire, continue Mustafa, sédentariser, lutter contre le chômage en créant des emplois dans le tourisme, les travaux publics et le pétrole. »
C’est en effet au nord du plateau de Tur Abdin, qu’au début des années 60, a été découverte la plus grande réserve de pétrole de Turquie, à Batman.
Entre essor démographique, villages et terres englouties par les constructions hydroélectriques, meilleurs rendements des terres agricoles, sédentarisation et un futur qui s’annonce radieux, les prix des terrains augmentent. « Les vieilles maisons de Mardin sont toutes en train d’être achetées et rénovées par les « tigres » anatoliens, confirme Mustafa. La spéculation va bon train et beaucoup de familles en profite pour quitter la région. »
D’autres en profitent pour truster des postes influents à l’échelle locale. En 1985, le gouvernement turc a mis en place un système de surveillance citoyenne avec la création des köy korucu, les « gardiens de villages ». Sébastien de Courtois cite à cet égard Dorronsoro, qui évoque une « période où se développent les réseaux les plus informels, avec une véritable compétition entre les institutions de sécurité […] Certaines pratiques sortent très directement de la légalité, les korucu étant liés à des groupes politiques/criminels ».
Les terres syriaques suscitent convoitises. La pression des korucu et des responsables politiques locaux qui leur sont liés participent à la phase finale d’une éradication rampante mais totale de la présence syriaque sur le plateau de Tur Abdin.
Retour sur les terres
Pourtant, doucement, les syriaques exilés reviennent sur la « Montagne des serviteurs de Dieu », « ce n’est qu’en occupant le terrain que l’on maintiendra notre culture », martèle le Métropolite Saliba Özmen.
Issa a 8 ans. Aujourd’hui comme tous les après-midi après la sortie d’école de son village, Beth Kusan, il va retrouver ses amis au « Château ». Cet endroit, c’est l’église Mor Eliyo, construite dans les premiers temps de la chrétienté, en 343. Le village compte une centaine d’âmes, la plupart syriaques, et le double en animaux. Certains exilés ont décidé de reconstruire les maisons et de vivre ici. Les enfants jouent innocemment sur les immenses murs entourant le lieu sacré, remplis d'histoires de chevaliers et de princesses. A cet âge-là, on ne comprend pas grand-chose à ces histoires de religions, de peuples, de guerres. Pourtant à un kilomètre de là, le camp militaire de Hah, les militaires patrouillent, les miliciens kurdes se baladent kalach’ à l’épaule dans le centre du village voisin, Orcana.
Les « églises-forteresses » suffiront-elles dans cette guerre de tranchées ? Le repli sur soi a commencé et les Syriaques restent sur leurs gardes. En ce dimanche matin, des femmes, têtes recouvertes d’un voile noir, marchent d’un pas pressé vers Mor Ahesnoyo, une des quatre églises syriaques encore en activité à Midyat. Elles rentrent en silence à l’intérieur dans la partie arrière de la nef. Un vieux monsieur vient me demander la raison de ma présence. Mon accent français le convainc de me laisser entrer. Le rideau de l’autel est ouvert, la révélation du Nouveau Testament a commencé. De part et d’autre, des jeunes fidèles répandent la parole sacrée en chantant, se répondant d’un côté à l’autre de l’abside.
Les paroles sonnent comme de longues complaintes, la musique et l’air vous serrent le cœur et vos yeux deviennent larmoyants. La foule de fidèles reprennent en chœur, l’atmosphère est chargée d’encens. Des prières, des espoirs glissés dans des murmures qui s’élèvent vers le ciel, les Syriaques ont l’habitude d’en faire. A la fin de la messe, on me décrit l’ambiance dans la région. « Suite à la publication de caricatures de Mahomet par le journal danois Jyllands-Posten, des musulmans en colère se sont réunis à Estel, un village appartenant à l’agglomération de Midyat, avec l’idée de marcher jusqu’au quartier chrétien situé ici. La foule a heureusement été interceptée par la police en chemin, me raconte le prêtre. » Paradoxalement, ce village est peuplé majoritairement d’anciens chrétiens convertis à l’islam.
Mais rien n’arrête la lente prise de contrôle par les autorités turques et kurdes de la zone, entre turquisation des noms des communes, construction de mosquées neuves dans les villages à deux pas des anciennes églises et écoles publiques dispensant l’étude du Coran. Le retour de quelques exilés ne modifiera pas la forme de champignon de la pyramide des âges des Syriaques en Turquie. Les civilisations sont souvent à l’image des Hommes : faibles et naïves, puis cultivées et progressives, pour finir avec une canne, des souvenirs de leur grandeur passée et un mausolée en ruine.
Que faire pour sauver cet héritage en péril ? Les Syriaques en Europe tentent de donner de la voix, en espérant que les négociations d’entrée dans l’Union Européenne poussera la Turquie à faire des efforts de sauvegarde du peuple syriaque.
Le soleil se couche sur Hasankeyf, splendeur posée sur les rives du Tigre. Le village sera en partie englouti par le nouveau barrage construit en aval. Les poissons seront au final les grands gagnants de cette histoire, propriétaires d’un monde que les hommes n’ont pas su partager. Je revois ces regards de soldats, ceux des Syriaques désemparés, celui de Mustafa, ils aspirent à une seule chose : retrouver la paix et obtenir le respect mutuel sur le plateau des Serviteurs de Dieu.
FΩRMIdea Paris, le 4 décembre 2016. Crédit Photo : Fred Daudon