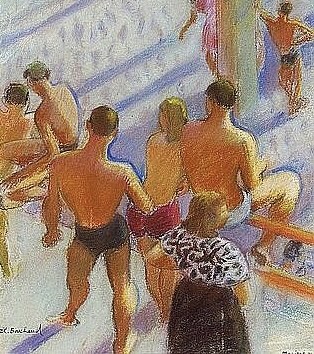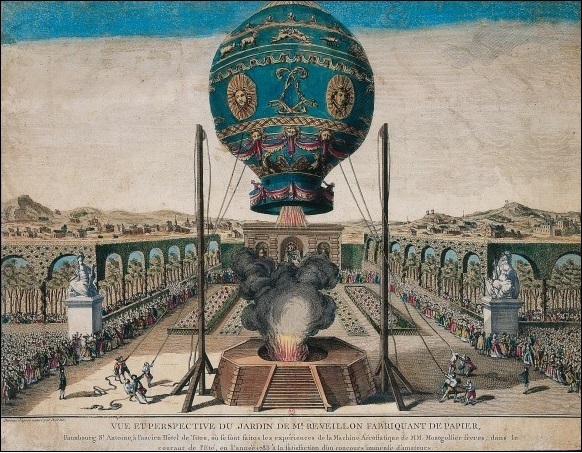Temps de lecture: 15 minutes (2 pages)
Français d’Algérie ?? Aïe ! Ça commence mal !
Passage d’une frontière
Timsit arrive à New York :
À la police de l’immigration, là, ça a été un peu plus long !
Mais c’est de ma faute !
La connerie !
Je suis né en Algérie !
Mais qu’est-ce qui m’a pris à moi de naître en Algérie?!
Faut être con, quand même ! (…),
Après, ils m’ont laissé passer !
Non, pas tout de suite… Ils m’ont d’abord fait un petit toucher rectal !
En Algérie, il y a des villes qui en imposent comme Alger, Oran et Constantine, mais pour moi comme dit Timsit, «la connerie !» c’est de ma faute, aïe aïe aïe, je suis né à Souk Ahras en Algérie !
Pour un douanier, tous les indicateurs de son tableau de bord cérébral sont au rouge vif, à chaque frontière je sonne au portique, j’endure une forte «pénétration» de suspicion par la police de l’immigration quand elle s’attarde une bonne heure sur mon passeport.
– Alors, vous confirmez que c’est bien vous sur la photo là ? Et comme ça on est né à Souk Ahras ? Hein ? Et en Algérie, en plus !
– Bé non, c’est compris dans le package m’sieur l’agent…Souk Ahras/Algérie…!
Heureusement mon binôme est blonde aux yeux bleus et comme Marlon Brando dans Le Dernier Tango, avec le beurre, elle tartine de son charme l’expertise de mon casier pour faciliter mon extraction… et ça marche !
Merci à toi !
Le paradis des Pieds noirs
La vie coloniale en Algérie était un paradis (colonial).
On était les «Pieds noirs», une vraie communauté avec une culture et une langue, juifs et chrétiens à côté des musulmans, pas avec, juste à côté.
Les Pieds noirs détenaient tous les privilèges, la vie quotidienne s’énonçait en français en pays arabe. On accaparait les emplois les plus cotés, les belles voitures et les appartements confortables. La vie était douce au soleil, une entre-aide constante comme inscrite dans le manuel du vivre ensemble. On vivait les uns chez les autres, et les autres chez d’autres encore qui finissaient chez les uns du début… Une vraie communauté, les hippies n’ont rien inventé !
Les portes et les fenêtres ouvertes, sur nous-mêmes et chez les autres, un nombril heureux, une insouciance de poisson rouge.
Dans la semaine, les hommes travaillaient et les femmes s’occupaient des enfants et de leur maison, les commérages sans limitation de décibel et les gazettes interchangeaient des balcons aux fenêtres.
Il n’y avait qu’un seul film par semaine au cinéma et le Paris Match hebdomadaire de France suffisait à alimenter largement les conversations.
L’école est en français, le maître arabe enseigne en français, sur les mêmes bancs, les arabes apprenaient comme nous que dans une époque lointaine le grand Sultan était le Roi Louis 14 qui portait une perruque ridicule et «se ‘crovait’ qu’il était riche» alors qu’il n’avait même pas un seul chameau et qu’une seule femme officielle. La chouma sur lui !
On jouait avec les arabes dans la cour, mais le ballon, le jeu de l’oie, le jeu de dames, les dominos étaient à nous les «patos», ils nous mettaient pourtant une belle tannée à la «boutique» ; à ce jeu il fallait exploser une pyramide de noyaux d’abricots à 10 pas, ils en avaient des kilos d’abricots les arabes, on était nuls avec nos petits sacs minables, mais on les niquait bien aux billes… ils n’en avaient pas !
La cuisine
La semaine se passait dans le ronron d’une vie sans histoire, les horaires des employés et des écoliers étaient aménagés à cause de la chaleur, les femmes cuisinaient beaucoup et en abondance, les petites quantités pouvaient détruire une réputation ; les plats naviguaient d’une porte à l’autre, toujours dans une marmite enveloppée d’un torchon à carreaux rouge et blanc noué sur le couvercle, un bouchon en liège glissé sous la poignée pour ne pas se brûler.
Quand on voyait arriver la gamelle par la porte toujours ouverte, on savait qu’on allait s’en mettre plein la lampe, les falafels de Mme Choukroun, ou le couscous tunisien au poisson de Mme Sammut… Le kif mon fils, profite ! (se dit avec l’accent en se tordant la joue entre le pouce et l’index !)
La juive Choukroun disait «œil pour œil, dent pour dent» et Sammut la maltaise répondait «pour un œil les deux yeux et pour une dent toute la gueule», c’était ça la tchatche à Bab El Oued !
Pour moi, rien ne valait la Mloukhia de notre fatma (les bonnes n’avaient pas de prénom, on disait comme ça, la fatma !). Ce plat est proscrit à Top Chef, même revisité par Pierre Gagnière, visuellement c’est la réplique exacte d’une bouse de vache, mais prodigieusement divin aux papilles.
Un matin avec la douceur d’une tractopelle, Paule Georgette l’a foutue à la porte, la fatma ; elle partait avec un lapin entier dans son soutien-gorge… Zarma t’as rien vu !
La vie coloniale
Mais la vie coloniale c’était le dimanche !
Pour ceux qui restent à Alger le dimanche, les hommes se rasent devant un miroir accroché à la poignée de la fenêtre ouverte, ils cirent leurs chaussures «qu’on se voit à dedans», de la gomina plein les cheveux noir corbeau et une chemise blanche, ils rejoignent les copains à la terrasse des bars et trinquent à la bonne vie algéroise, l’anis gras à la main, on mâche des glibettes et des zitounes et on jette les noyaux dans le caniveau avec les mégots de gauloises bleues ; pendant que leurs femmes préparent des plats qui rejoindront d’autres plats préparés par les cousins chez qui on ira déjeuner jusqu’à la nuit ; les enfants endimanchés auront la consigne de ne pas se tacher de la journée et comme ce sera impossible, ils prendront une sacrée bonne fessée vers 17h en général…
Pour les adolescents, l’après-midi, ils iront se «taper un bain» vers le port en espérant apercevoir des filles…
Jusqu’en 58 la nouba se passait à Cap Zébib en Tunisie, après 58 ce sera Sidi Ferruch ou Fort-de-l’Eau en Algérie, le bord de mer, une dizaine de voitures (la 4 Chevaux grise puis la Dauphine verte 925HJ9A, A comme Alger, Zouina !) tankées de gosses, de casseroles, du charbon pour les grillades, les boules de pétanques et trop trop trop de nourriture, arrivés sur le sable, on installait un campement de Touaregs pour un méchoui géant…
Au bord de mer, on mordait les extrémités de la serviette pour changer de culotte, les hommes pêchaient les oursins pour la kémia (apéro), on coupait la soubressade (saucisson), truandait dans les zitounes, le tout arrosé d’anisette (pastis)… les femmes préparaient le monstrueux repas, la sauce piquait coriace et ça jouait aux boules jusqu’à la nuit à la lumière des phares de voitures pour finir la partie… Des jeux de mots minables fusaient : «T’i a vu Monte Carlo, non j’ai vu monter personne !» au son des rires alcoolisés des hommes et aux sourires forcés et gênés des femmes, on pouvait deviner que d’autres plaisanteries étaient gaillardes voire plutôt salaces, incompréhensibles par les enfants qui sont restés dans l’eau jusqu’à ce que leurs lèvres soient bleues…
Le pataouète
Le Pied noir est un virtuose de la langue, le pataouète est un chaos d’italien, espagnol et arabe mêlé aux déformations locales du français de Bab El Oued…
Edmond Brua a parodié la tirade du Cid de Corneille la plus connue :
¡Qué rabia! qué malheur! Pourquoi qu’on devient vieux ?
Mieux qu’on m’aurait levé la vue des yeux !
Ce bras qu’il a tant fait de fois le salut militaire
Ce bras qu’il a porté tant de sacs de pon’s de terre
Ce bras qu’il a gagné des tas de baroufas
Ce bras, ce bras d’honneur, le voilà qu’y fait chouffa !
Quand ça chauffait dans un bar, les deux adversaires face à face, dressés sur leurs ergots, chacun d’eux avec son clan «à darrière de lui», c’était souvent Riri, Jojo, l’oncle Gus et le petit dernier c’était Jacky le couillon, et c’était parti, c’était ça une barouffa : «viens viens là, ta mère, qui c’est qui me tient la veste, je vais le massacrer ! Putain ! Qui c’est qui me retient ! La con de sa mère, tenez-moi ou je lui fais sa tête au carré qui va faire quatre cinq fois cinq six tours, nardinamouk !»
Tout restera verbal, rien de physique, mais aucune économie de gestes, cette hyper-gesticulation serait un régal pour la Commedia Dell’Arte, si on avait pu exporter ces spectacles de rue.
Le patriarche
Épuisé par la journée à la mer, je m’endormais dans la voiture au retour alors que j’avais bien vomi à l’aller comme d’habitude, le mal des transports. Dès que les portes de la voiture claquent, la récréation est terminée, c’est le signal, les serrures se ferment sur la cellule (familiale), on rentre au pénitencier, on ne parle plus, on ne rit plus, on ne bouge plus, discipline et rigueur… Sinon la distribution de baffes pour tous par le maton-Paul-Eugène peuvent pleuvoir sans sommation… Direction la maison (d’arrêt), tout cesse, les bruits, la gesticulation ; le sympathique compagnon de la partie de plage que l’on nous envie, se transforme dès l’entrée en voiture en Dragon de Komodo, surtout ne pas déranger ou déplaire, il vous en cuirait… La violence en famille, que les auteurs(es) décrivent en reniflant leurs larmes sur la page blanche en espérant émouvoir les lecteurs (trices), est une banalité.
Chez nous pas besoin de rêver s’inscrire aux cours de musique, de sport ou de danse, je ne parle pas du cheval ou du dessin.
Oui ! Quand je renâclais à manger de la soupe trop chaude, le molosse me plongeait le visage dans l’assiette.
Oui ! Quand je tardais à manger à table, j’étais exclu aux toilettes avec mon assiette.
Oui ! À la moindre agitation d’enfant, on commençait par une gifle façon Lino Ventura, ensuite la ceinture et une fois à terre les coups de pieds.
À la fin de la lecture de mon carnet de notes, on me changeait à cause de l’odeur.
Le spectacle avait plusieurs tableaux parce qu’ensuite la tornade s’abattait sur les deux autres membres de l’équipe, Paule Georgette comprise, mais dans notre écurie, comme en 42 en France, la collaboration, la délation et la fuite pour sa propre survie prévalaient à tout… Solidarité, dans ton cul… Pas de famille qui tienne, sauve qui peut !
En l’absence du «Parrain», Paule Georgette s’y collait aussi à coups de cuillers en bois de cuisine, qu’elle me cassait sur le dos, les fessées classiques et si un gros mot m’échappait, elle craquait une allumette et me brûlait la langue, rien que du banal, simple, mais très efficace…
A Kouba, un quartier d’Alger, j’ai 7 ans, je vomis chaque matin avant l’école, sans que l’on s’alarme, je prends conscience, sans pédopsychiatre, mais c’était trop facile, que je ne jouerai pas les sacs de frappe très longtemps dans cette famille.
Rimbaud écrit sur ses 7 ans à lui :
L’âme de […] (l’) enfant livrée aux répugnances.
Tout le jour il suait d’obéissance ; (…)
des tics noirs, quelques traits
Semblaient prouver en lui d’âcres hypocrisies.
Dans l’ombre des couloirs aux tentures moisies,
En passant il tirait la langue, les deux poings
À l’aine, et dans ses yeux fermés voyait des points.
Je commence à cultiver la Révolte, le Vice et la Haine sans le talent du poète mais c’est mon frère d’armes ! Je n’ai pas attendu non plus Maurice Pialat pour hurler dans ma tête :
«Si vous ne m’aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus!»
Le combat est trop inégal, la gifle de la brute recouvre ma nuque d’une oreille à l’autre, tous les Pieds noirs connaissent cette «calbotte» meurtrière, le cervelet titube, mais je suis Jake La Motta l’encaisseur, je ne suis jamais compté 10.
Quand je rentre au dépôt, c’est automatique, j’éteins mon cerveau, plus aucune information, sensation ou émotion ne dérangent ma nuit cérébrale, dans mon brouillard je m’insensibilise… Séquestré au port par les autorités, je tisse mes voiles en secret, pour les mettre (les voiles) à la première fenêtre météo.
La révolte
Mais voilà que le volcan en attente se met à dégueuler ses tripes !
Un de nos maîtres d’école, Mr Beytout, faisait régner la discipline dans la classe avec une balle de tennis, comme Cyrano : «A la fin de l’envoi je touche», il lançait et touchait en pleine tête, sans jamais rater sa cible ; en 61, il fut lui-même touché par une balle (pas-de-tennis celle-ci), en pleine tête aussi, juste en bas de ma rue, dans son garage, rideau de fer ouvert, on a vu son corps plié sur le capot de sa 403 Peugeot verte, le sang séchait sur la carrosserie, le voisinage totalement pétrifié, figé, assiste, le tueur était-il un de ces spectateurs ?…
En 58, Paul Eugène fut éjecté de Tunisie à coup de pied au cul avec sa smala, sa petite villa de Mutuelleville à Tunis, au milieu des amandiers et la quiétude de sa vie de fonctionnaire doublement payé est terminée. On lui a offert de regagner la France dans de bonnes conditions, la décolonisation de la Tunisie se faisait en douceur.
Visionnaire politique, il décida d’aller s’installer à Alger alors que la Toussaint rouge du 1er Novembre 54 avait eu lieu 4 ans plus tôt, la grosse boulette !